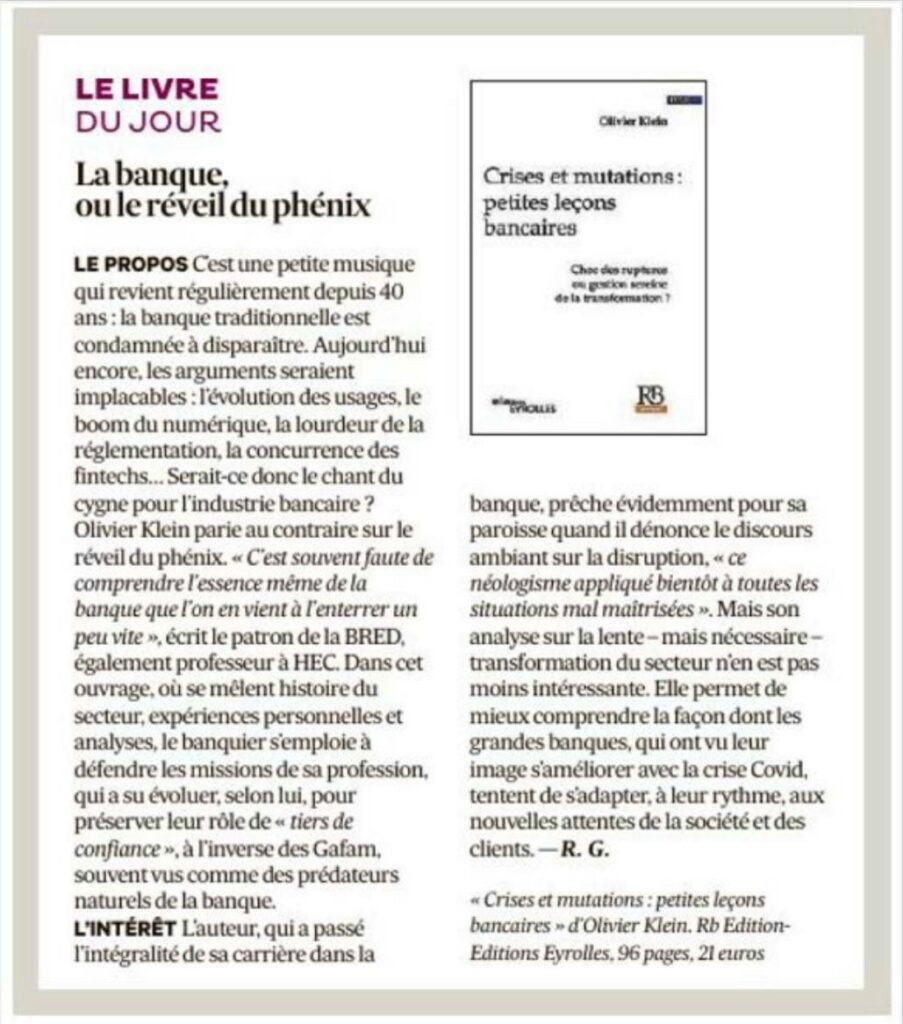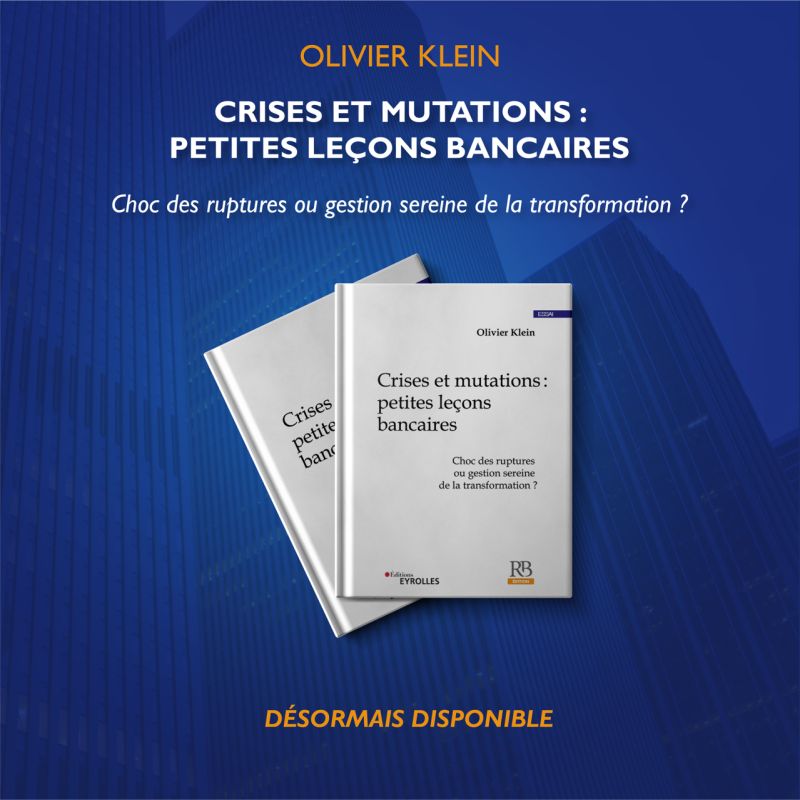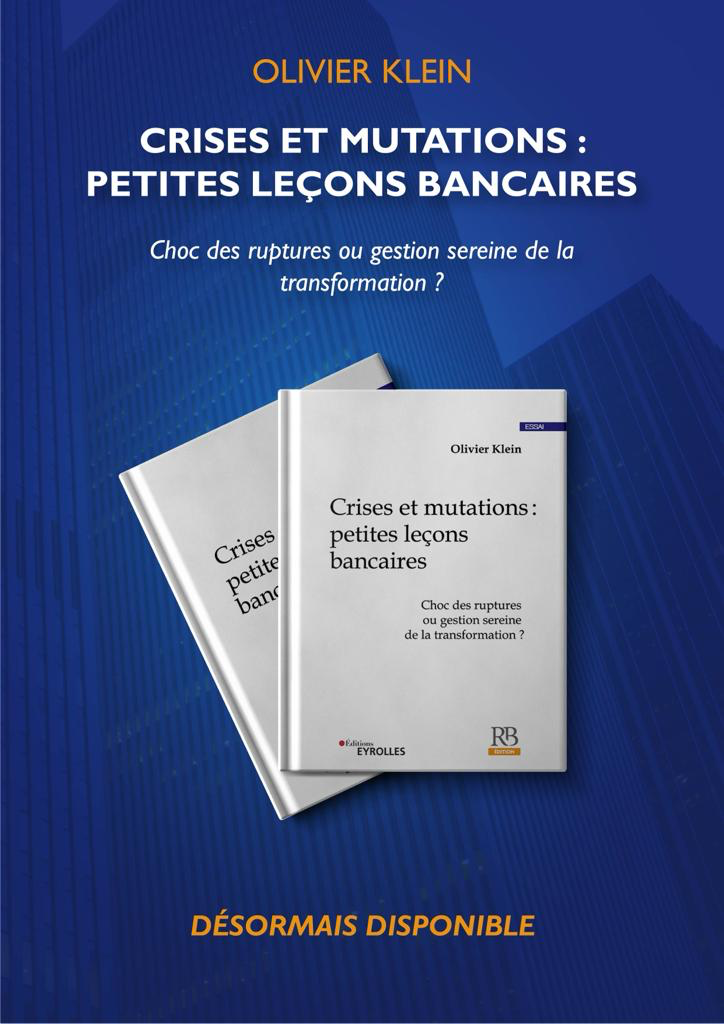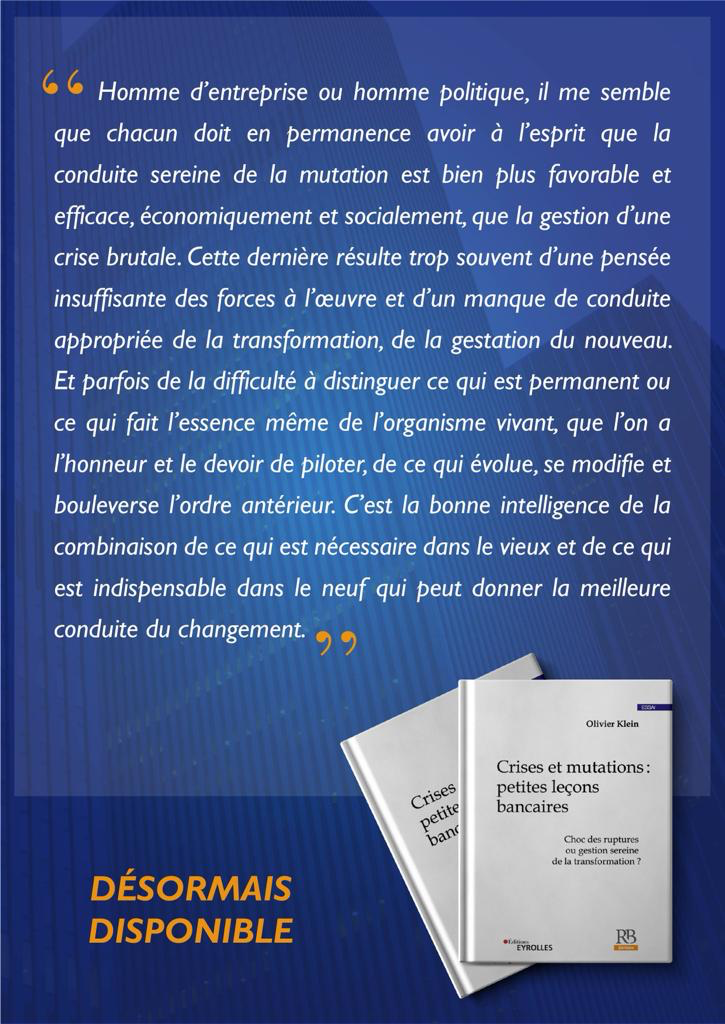Lors des crises graves, la politique monétaire conventionnelle et non conventionnelle joue un rôle essentiel. Elle conduit les taux d’intérêt courts et longs à des niveaux très bas, inférieurs au taux de croissance. Ces taux très bas jouent favorablement directement sur la demande, et indirectement en augmentant la valeur des actifs patrimoniaux (immobilier et actions notamment). Cette politique facilite également le désendettement en rendant la dette plus aisée à rembourser. Les « spreads » sont de même poussés à la baisse afin d’éviter qu’ils ne déclenchent un enchaînement catastrophique de faillites par une montée brutale de l’insolvabilité.
Pourtant, une telle politique monétaire menée trop longtemps peut elle-même devenir une source sérieuse de danger et un risque important pour la stabilité financière. S’il est très utile et même indispensable que les banques centrales aient adopté ce type de politiques dans ce genre de situations, de la grande crise financière à la profonde récession due aux conséquences économiques du traitement de la pandémie, on assiste en réalité à une asymétrie problématique lorsque la croissance est de retour avec une reprise notable du crédit et que les banques centrales n’inversent que peu ou pas leur politique, en n’augmentant pas ou trop peu leurs taux d’intérêt et en ne diminuant pas ou trop peu leur politique de « Quantitative Easing ».
Dès 2017, la croissance en zone euro se rétablissait de façon satisfaisante et l’octroi du crédit avait retrouvé un rythme élevé. Cependant la politique de la BCE restait inchangée. La raison affichée en était une inflation encore trop basse, c’est-à-dire une cible d’inflation non encore atteinte. Ce qui justifiait aux yeux de la banque centrale le maintien d’une politique monétaire ultra accommodante. Mais la politique monétaire pouvait-elle la faire remonter ? L’inflation n’était-elle en effet pas structurellement et non conjoncturellement basse ? Or, en tel cas, il devenait dangereux de continuer de mener une telle politique trop longtemps car elle maintient alors des taux d’intérêt inférieurs aux taux de croissance, donc des taux d’intérêt trop bas et ce, trop longtemps (too low for too long). Ce qui induit le retour d’un cycle financier, c’est-à-dire d’un endettement qui montait plus vite que la croissance économique, comme le retour de bulles sur les actifs patrimoniaux, et notamment sur l’immobilier et les actions. Avec un effet de boucle, comme dans tout cycle financier, car l’endettement sert aussi en ce cas à acheter ces actifs, ce qui nourrit les bulles et rend à son tour possible le fait de s’endetter davantage.
La conséquence en est, à chaque fois que les taux d’intérêt sont trop bas trop longtemps, d’augmenter la vulnérabilité financière de l’ensemble de l’économie, avec des risques dangereusement aggravés incorporés dans les bilans, tant à l’actif des uns qu’au passif des autres.
1/ A l’actif des investisseurs financiers et/ou des épargnants
Dans une telle situation de taux d’intérêt, ces acteurs cherchent à tout prix un peu de rendement, puisque les taux d’intérêt sont trop bas. Ils vont donc prendre de plus en plus de risque à cette fin. Les primes de risque sont ainsi comprimées à leur tour de manière anormale et dangereuse, car lorsque les bulles éclatent, les « spreads » n’auront tout simplement pas couvert le coût du risque avéré. L’actif des épargnants, comme l’actif des investisseurs financiers, qui travaillent pour les épargnants (les fonds de pension, les assureurs, les fonds de placement, etc.), sont ainsi rendus vulnérables. Cela a conduit, dès avant la pandémie, à une baisse historique des rendements des placements dans les infrastructures, à des « spreads » historiquement bas sur les dettes « High yield » comme « investment grade » , à des niveaux de valorisation des entreprises en bourse ou en « private equity » très élevés, à des fonds de placement détenant de plus en plus d’actifs illiquides et/ou de maturité très longue, alors qu’ils assurent une liquidité quotidienne de ces mêmes fonds, etc.
2/ Au passif des emprunteurs
Dans cet environnement, les emprunteurs ont tendance à trop s’endetter, puisque le coût de l’argent est faible en regard du taux de croissance, ce qui entraîne des leviers trop élevés. Avec entre autres des rachats d’actions par les sociétés elles-mêmes, notamment aux Etats-Unis. Les entreprises concernées deviennent ainsi vulnérables. Elles sont vulnérables à une baisse des cashflows liés à un ralentissement de la croissance, aussi bien qu’à une remontée des taux d’intérêt. Cela conduit ainsi à un risque fortement accru d’insolvabilité dans le futur.
La conjugaison des deux points ci-dessus provoque donc une situation de forte vulnérabilité financière globale. En outre, cette situation entraîne une croissance du nombre d’entreprises zombies, c’est-à-dire d’entreprises qui subsistent, bien qu’elles ne soient pas rentables structurellement. Elles feraient en effet faillite avec des taux d’intérêt normaux, c’est-à-dire égaux au taux de croissance nominale. Ce phénomène induit une moindre efficacité globale de l’économie et des gains de productivité affaiblis.
Le maintien de taux d’intérêt trop bas trop longtemps, alors que de tels taux ne sont plus nécessaires pour lutter contre une croissance insuffisante de l’économie et des crédits, installe donc une situation macro-financière très risquée à long terme. Cette asymétrie de la réaction de la politique monétaire peut ainsi conduire à de graves crises financières.
Telle était d’ailleurs la situation pré-Covid. La situation financière a ainsi tourné à la catastrophe au tout début du Covid, car la pandémie a produit une chute vertigineuse de la production et à des contractions violentes de revenus et des cash-flows pour les entreprises de plusieurs secteurs. Fin mars, la crise financière entraînée par le Covid était ainsi plus forte que celle de 2008-2009, avec une volatilité des actions deux fois plus grande, des « spreads » qui ont bondi violemment, une liquidité, notamment des fonds de placement, devenue soudainement très problématique. Heureusement, les banques centrales ont répondu extrêmement rapidement : elles ont abaissé leurs taux lorsque c’était encore possible, aux États-Unis notamment. Elles se sont mises également à acheter des dettes publiques et privées, y compris du « High yield », et parfois même des actions, en accroissant considérablement leur Quantitative Easing. Elles ont aussi adapté utilement les mesures de réglage macro-prudentiel. Les banques centrales ont ainsi permis à très juste titre de soulager en quelques semaines une situation financière catastrophique et ont soutenu les efforts des Etats en faveur de l’économie, grâce à une utilisation massive de la politique monétaire non conventionnelle.
La question va commencer à se poser, si la pandémie ne repart pas : comment peut s’envisager la sortie d’une telle politique monétaire, lorsque la croissance sera revenue de façon régulière à un niveau satisfaisant, alors que l’endettement des Etats et des entreprises a cru encore bien davantage qu’avant la pandémie ? Sans mettre fin de façon précipitée aux mesures extraordinaires de soutien des Etats et des banques centrales, il faut malgré tout réfléchir dès à présent à la sortie à terme d’une situation exceptionnelle où les Banques Centrales auront à raison suspendu transitoirement la logique du marché, en mettant entre parenthèses la contrainte monétaire portant sur les acteurs privés comme sur les Etats.
Il faudra faire face à une situation de très fort endettement de nombreux Etats mais aussi d’entreprises, et à des bulles sur les actifs patrimoniaux. Si l’on remonte alors trop rapidement les taux notamment par un retrait mal calibré des « Quantitative Eeasing », cela peut avoir un effet désastreux sur l’insolvabilité privée et publique, et entraîner un krach sur les marchés des actifs patrimoniaux, ce qui renforcerait l’insolvabilité générale. La sortie doit donc être très progressive et mesurée.
Ajoutons que, si l’inflation n’était pas qu’un phénomène transitoire (elle se renforce actuellement alors que l’on a soulevé le couvercle pesant sur les économies et que la pénurie de main d’œuvre dans de nombreux secteurs, à forte comme à faible valeur ajoutée, se fait jour de plus en plus clairement), cela poserait des questions très compliquées aux banques centrales. Devraient-elles maintenir la solvabilité des agents économiques au prix d’une inflation éventuellement incontrôlée ? Ou l’inverse ?
Mais, même si un nouveau régime inflationniste n’apparaissait pas, les banques centrales devraient-elles poursuivre leur « Quantitative Easing » à l’infini, si les Etats et les entreprises volens nolens ne se désendettaient pas ? Ce serait au prix alors d’une instabilité financière structurellement accrue, tant en termes de surendettement que de bulles de plus en plus fortes, avec les très graves risques économiques, financiers et sociaux inhérents à l’avènement inéluctable de crises en résultant. Et au prix d’un aléa moral de plus en plus élevé, les emprunteurs, privés et publics, ne craignant plus les situations de surendettement. Au prix encore d’investisseurs comprenant qu’ils détiennent à tout jamais une option gratuite de la part des banques centrales les protégeant contre les krachs et qui seraient ainsi incités à sous-pondérer durablement le prix du risque dans leurs calculs financiers. Au prix enfin d’une économie qui connaîtrait de plus en plus d’entreprises zombies, empêchant la destruction créatrice nécessaire à la croissance et entraînant une baisse durable des gains de productivité, donc, entre autres, freinant structurellement les augmentations de pouvoir d’achat non inflationnistes.
A l’horizon, le risque d’une monétisation sans limite des dettes conduirait en outre à une situation catastrophique de fuite devant la monnaie. Un système monétaire sain et efficace est, en effet, un système de règlement des dettes fiable et digne de confiance. Donc, si une solvabilité artificielle était trouvée grâce à un maintien des taux d’intérêt à un niveau durablement trop bas, le niveau d’endettement pourrait alors s’élever sans contrainte apparente, jusqu’à créer une véritable crise de confiance dans la valeur des dettes et in fine de la monnaie.
Ainsi, pour conserver leur crédibilité, donc leur efficacité, y compris lors des futures crises systémiques, les banques centrales doivent se prémunir contre le risque bien connu de « fiscal dominance ». Mais aussi contre celui de « financial market dominance ». C’est-à-dire qu’elles ne soient pas dominées par les Etats, qui pourraient souhaiter une intervention ininterrompue des banques centrales pour « garantir » leur solvabilité. Mais qu’elles ne soient pas non plus dominées par les marchés financiers. Les banques centrales doivent en effet être dans une relation stratégique avec les marchés financiers, mais elles ne doivent pas avoir peur de les canaliser autant que possible vers des plages de fluctuation soutenables, voire de contrer les représentations collectives et opinions moyennes des marchés lorsque leur mimétisme les amène à développer des bulles spéculatives. Et ce, alors même que les marchés demandent aujourd’hui toujours plus d’injections monétaires pour poursuivre leur dynamique haussière. Jérôme Powell, le Président de la Fed, disait d’ailleurs très justement récemment : « Le danger, c’est de rester coincé dans une zone où nous ne voulons pas être, sur le long terme. Ce que je redoute, c’est que certains veuillent que nous utilisions ces pouvoirs plus fréquemment, davantage que dans les seules situations de crise impérieuse ».
Mais,à côté des politiques de banques centrales – qui doivent déjà réfléchir à la meilleure façon de sortir ultérieurement de leurs politiques ultra accommodantes-, il est nécessaire de conduire des politiques budgétaires soutenables à moyen terme. En prenant soin de ne pas provoquer de récession en agissant trop brutalement. Mais il leur faut en même temps bien expliquer qu’il ne peut y avoir d’argent magique et que les mesures prises pendant la pandémie ne peuvent être que strictement extra-ordinaires et en aucun cas poursuivies durablement. Il faut donc que les Etats mènent des politiques structurelles (investissements et réformes) qui sont indispensables pour augmenter le potentiel de croissance de leur économie. Il leur faut dès à présent expliquer qu’il est temps de se mobiliser fortement pour faciliter la croissance, par plus de travail. En France, notamment par la réforme des retraites et celle du marché du travail, alors que nombre d’entreprises font face à des goulots d’étranglement, y compris dans leurs embauches. Il s’agit là in fine de la meilleure façon de sortir progressivement du surendettement.
Les Banques Centrales ne peuvent en effet pas tout faire toutes seules et leur en demander trop peut s’avérer très dangereux. Pour l’économie, mais aussi pour leur efficacité même, lorsque cela s’avérera à nouveau nécessaire.
Bibliographie
Olivier KLEIN : « Le rôle irréductible des banques commerciales » La revue Banque & Stratégie, avril 2021
https://www.oklein.fr/le-role-irreductible-des-banques-commerciales/
Olivier KLEIN : les voies économiques étroites de l’après Covid – Les Echos, 16 février 2021
https://www.oklein.fr/les-voies-economiques-etroites-de-lapres-covid/
Olivier KLEIN : Le non remboursement de la dette ? Un risque de perte de confiance dans la monnaie et un risque pour la société – Les Echos, 20 novembre 2020
https://www.oklein.fr/le-non-remboursement-de-la-dette-un-risque-de-perte-de-confiance-dans-la-monnaie-et-un-risque-pour-la-societe/
Olivier KLEIN : L’après confinement : ni austérité ni économie vaudoue ! – Les Echos , 14 mai 2020
https://www.oklein.fr/lapres-confinement-ni-austerite-ni-economie-vaudoue-retrouvez-la-version-complete-de-ma-tribune-publiee-dans-les-echos-du-14-mai-2020/
Olivier KLEIN : The debt issue : risk of financial instability and of a loss of trust in money – Conference EuroGroup 50, 12 décembre 2020
https://www.oklein.fr/en/the-debt-issue-risk-of-financial-instability-and-of-a-lost-of-trust-in-money/