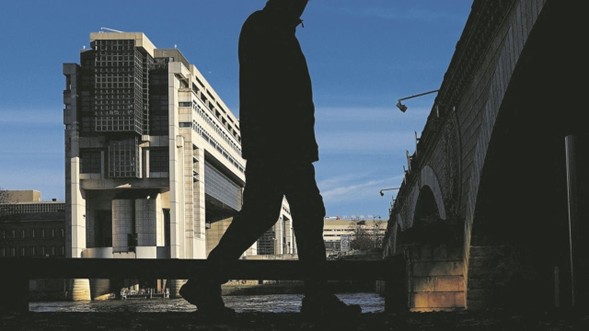“Un État qui s’immisce partout ne fait pas que fragiliser les institutions ; il détruit également les relations de confiance entre les citoyens, car il s’interpose entre eux et les rend étrangers les uns aux autres.”
(La Crise de la culture) Hannah Arendt
La pensée social-démocrate, telle qu’elle existe en France, a vécu. Elle a beaucoup apporté pendant des décennies. Mais son modèle intellectuel n’a pas beaucoup évolué, alors qu’a minima quatre mouvements d’importance se sont produits. Ils ont été occultés, non pensés, parfois niés, ou, pire même, suivis sans en voir les conséquences. Citons-les sans ordre de priorité. La question de l’autorité publique, de la sécurité et du phénomène migratoire avec le développement de l’idéologie islamiste. Embarquant ainsi la réflexion sur ce qui fait nation. La montée d’un individualisme farouche, avec la survalorisation des droits de chacun et la dévalorisation des devoirs. L’obsession de l’égalité, impliquant un dangereux égalitarisme, au détriment-même de la recherche de l’égalité des chances et de l’équité. Le développement enfin d’une hypertrophie de la sphère publique, dont l’entropie engendre inefficacité, découragement, perte de confiance et montée de l’inquiétude.
Nous reviendrons sur chacun de ces points. La question de la nécessaire transition climatique n’est pas ici citée, car la social-démocratie, avec toutefois trop de dogmes et une démarche insuffisamment scientifique, l’a plutôt bien intégrée dans son logiciel. La social-démocratie doit ainsi renouveler sa réflexion, sous peine de devenir obsolète, en abordant quelques territoires jusqu’ici, en son propre sein, trop peu explorés. Tentons modestement d’en poser quelques briques.
Marché et Etat
Le marché est indispensable, car il développe une dynamique économique, une allocation des moyens et une adéquation de l’offre et de la demande certes imparfaites, mais irremplaçables. Toutefois, le marché ne peut être un mode de régulation suffisant par lui-même car, pour être durablement efficace et suffisamment stable, il a besoin de droit, de règles, d’autorités institutionnelles, d’organes de régulation, comme de corps intermédiaires, permettant d’agir lorsque le marché se dérègle et qu’il connaît une dynamique déstabilisante. La sphère publique est donc indispensable à la régulation du marché, de l’économie et plus généralement de la société. Ainsi, l’Etat (au sens large) est-il nécessaire pour le bon équilibre de la société, y compris en favorisant l’existence de corps intermédiaires, tels que les syndicats, pour la bonne régulation du tout. Les différentes forces d’une société sont alors canalisées de façon globalement harmonieuse, dans un jeu d’équilibre, même si cet équilibre est par nature changeant et instable. Et ce modèle de régulation a permis, cahin-caha certes et sans linéarité avérée, un développement du bien-être. Et ce, de façon relativement bien partagée dans les pays européens.
Jusqu’alors, les manifestations les plus abouties de ce mode de régulation de la société, assurant une bonne combinaison de l’éthique et de l’efficacité, sont apparues en Europe du Nord et en Allemagne. Puis, avec des nuances, une forme de social-démocratie s’est généralisée à l’Europe et en est devenue, volens nolens, l’une de ses caractéristiques fortes. Au total, la social-démocratie, avec des variantes, a permis pendant des décennies une combinaison réussie du marché et d’institutions et de règles, (y compris redistributrices).
Nous utiliserons donc le terme de social-démocratie dans un sens large, c’est-à-dire au-delà des alternances entre les droites et les gauches de gouvernement, comme le socle commun définissant globalement bien le mode de régulation des pays européens.
Cependant l’Europe semble connaître aujourd’hui un déclin relatif, et même, depuis quelques années, un décrochage économique significatif face au modèle américain notamment. La multiplication des normes, des règlements, la moindre incitation à l’initiative comme à la prise de risque, comme la volonté d’égalité -et non d’équité -se développant sans limite, paraissent en être quelques éléments d’explication. La pensée de la social-démocratie, y compris dans ses courants réformistes conscients de cette trajectoire dangereuse, est en fait devenue insuffisante.
Il est tout d’abord indispensable d’englober dans la pensée social-démocrate de l’action publique les questions d’autorité publique, de sécurité, comme de meilleure régulation et intégration de l’immigration. Sous peine, à défaut de traiter ces questions de façon républicaine, de laisser le monopole du discours sur ces sujets aux mouvement populistes. Mouvements alors capables d’attirer les électeurs à juste titre mécontents de n’être pas entendus sur des sujets sensibles de leur quotidien. Ces sujets sont cruciaux, et il doit être souligné qu’il est rédhibitoire de les traiter de façon moraliste ou avec mépris. Ajoutons, dans la même ligne, que penser un pays, une nation, comme un caléidoscope multiculturel sans unité, sans réelle frontière, sans culture commune, sans véritable identité, avec pour seul partage des valeurs universelles désincarnées, est une vision éthérée, dans laquelle on fait se dissoudre l’histoire, la géographie, et la Nation elle-même. Et où l’on occulte les liens culturels qui forgent un pays, qui permettent à ses habitants de s’y reconnaitre et de vivre ensemble. Nier cette vérité c’est provoquer le pire tôt ou tard, volens-nolens. Renan avait déjà tout dit : « Ce qui nous unit, ce n’est pas une langue, une religion, ou une race, c’est un passé commun et une volonté partagée de vivre ensemble. Une nation est une âme, un principe spirituel, fondé sur le souvenir des gloires passées et sur le consentement actuel à continuer cette vie commune. Une nation, c’est un plébiscite de tous les jours. » Que cela inspire la réflexion ! Ces sujets, pour fondamentaux qu’ils soient, ne font cependant pas l’objet de développement spécifique dans cette note.
Ensuite, doit être analysée avec attention la perte d’efficacité de la sphère publique. Comme le marché n’est pas exempt d’erreur et de dysfonctionnements endogènes, les décisions des pouvoirs publics elles-mêmes peuvent ne pas être efficaces, voire ne pas être les bonnes. Il n’y a ni omniscience des marchés, ni omniscience de l’Etat. Il est indispensable de considérer, au-delà de toute idéologie, qu’une politique publique peut en effet ne pas être efficace. Pire, qu’elle peut ne pas être appropriée, et même non souhaitable. Qu’elle peut même induire des effets pervers aboutissant à l’exact contraire de ce qui était désiré. Cette base de réflexion doit faire partie du cœur du renouveau de la pensée social-démocrate. Il est ainsi opportun de noter qu’il n’y a pas le « méchant capital » et le « gentil État ». Pas de camp du mal et de camp du bien. Cette vision manichéenne est non seulement simpliste mais également dangereuse car très trompeuse. Il y a le capital et son double[1], tous deux connaissant leur propre logique de développement sans fin. Là, de rendement, de capitalisation, d’accumulation du capital aurait-on dit autrefois. Ici, de contrôle, de pouvoir. Tous les deux, éprouvant comme tout organisme vivant, la nécessité vitale de croître. Et pourtant, tous les deux sont nécessaires et complémentaires, dès lors que l’on ne laisse ni l’un ni l’autre s’imposer à tous et déstabiliser le délicat équilibre qui permet de combiner efficacement les deux. C’est ce qui autorise une société de progrès.
La logique de développement de l’Etat : la suradministration
Il faut donc penser librement pour faire l’analyse du développement, depuis des décennies en France, d’un Etat omniprésent, tendant à intermédier les relations de chacun avec l’autre, c’est-à-dire de chacun avec la société. Cet Etat établit un contrôle toujours plus serré sur les individus et développe dans une logique d’entropie une suradministration toujours plus lourde et pesante, et à rendement décroissant.
Si la logique de développement de l’Etat et de la sphère publique doit être pensée, c’est, bien plus qu’aux Etats-Unis, chez nous en Europe et plus particulièrement encore en France que cette analyse critique doit être faite. La suradministration développe le sentiment d’impuissance et partant le découragement et le passéisme. Mais aussi la recherche de l’avantage maximal pour soi-même. Ou encore, chez certains, l’envie de sédition, d’insoumission. Par la logique de croissance sans fin qui lui est propre, la suradministration tente de répondre à tous, en infantilisant les gens et en poussant sans cesse à plus de demande d’Etat. Ce qui amène inéluctablement la déception. Et développe, à son tour, l’angoisse, la peur devenue insurmontable devant tout problème fût-il petit, tant le sens de la responsabilité individuelle a été réduit, abîmé. Trop d’Etat induit une atomisation[2] des individus et leur aliénation quant à leur capacité à agir par eux-mêmes. La suradministration et un Etat trop intrusif et omniprésent peuvent conduire en effet à un affaissement de la confiance en soi-même, mais aussi entre les uns et les autres. Ils sont un frein à l’action individuelle et collective. Et ils entraînent une perte de solidarité auto-organisée entre les membres de la société. “L’action est ce qui permet aux hommes d’apparaître devant les autres, de se révéler dans leur singularité et de construire un monde commun. Lorsque l’État monopolise cette capacité, les citoyens sont réduits au rôle de spectateurs. » Hannah Arendt (La condition de l’homme moderne).
En bref, ainsi que le pense avec beaucoup d’acuité Hannah Arendt, cette dynamique induit une perte de l’équilibre nécessaire entre, d’une part, la liberté et la responsabilité individuelle et collective et, d’autre part, la nécessaire régulation pour organiser une société juste. “Le danger, ce n’est pas seulement la violence des régimes autoritaires, mais le glissement progressif vers une administration douce et paternaliste qui asphyxie la liberté sous prétexte de protection.” écrit-elle encore.
La combinaison essentielle de l’éthique et de l’efficacité
Face aux erreurs possibles de la sphère publique, mais aussi face à sa tendance à s’étendre toujours davantage jusqu’à perdre significativement de son efficacité et à développer des freins défavorables à la dynamique de la société, il faut redonner à l’Etat au sens large de la vision et de la vigueur pour accomplir sa tâche au mieux. Il lui faut éviter de se développer de façon superfétatoire. Et éviter de dicter des lois et des règles comme d’engendrer des institutions diverses et variées non strictement nécessaires au bon fonctionnement de l’économie et plus généralement de la vie en société. La sphère publique se doit donc d’assurer la meilleure combinaison de l’éthique et de l’efficacité. Chacun de ces deux termes n’étant en aucun cas l’apanage du seul marché ou du seul Etat. Le partage des rôles en ce domaine est bien plus complexe et imbriqué. Éthique et efficacité, deux termes qu’il est utile de marier dans l’entreprise comme dans la société dans son ensemble, tant ils sont indispensables l’un à l’autre, dans une tension dialectique. L’un ne peut durablement rien sans l’autre et réciproquement. Il n’y a pas d’éthique durable sans efficacité, de même qu’il n’y a pas d’efficacité soutenable sans éthique. Et les deux n’étant en aucun cas l’objet de logiques dichotomiques et opposées. Les pouvoirs publics doivent penser en permanence cette dialectique.
Hyper démocratie et hyper social-démocratie
Il faut également s’interroger sur la pente naturelle de la démocratie comme de la social-démocratie, sur leur dynamique endogène. Sur ce que j’appelle l’hyper-démocratie et l’hyper social-démocratie. Elles peuvent en effet produire par elles-mêmes leurs propres excès. Tocqueville déjà prévenait de cette logique endogène à la démocratie. Si l’on ne développe pas une réflexion approfondie sur ces trajectoires, la démocratie, de même que la social-démocratie peuvent conduire à leur propre affaiblissement, mais aussi, au bout du chemin, à leur possible disparition. Avec en point de mire l’avènement au pouvoir du populisme, fût-il très à droite ou très à gauche.
On ne pourra donc faire l’économie d’une réflexion sur les excès spécifiques de la démocratie, engendrés par sa propre dynamique. Le droit de tous, étendu, sans fin, à tout. Opposable à tous les autres. Et symétriquement, l’abandon progressif des devoirs. C’est-à-dire l’individualisme et l’égoïsme poussés au maximum et le communautarisme -segmenté à l’extrême-, exacerbé. Les deux étant des signes d’absolu repli sur soi total. Avec, en surplus, comme manifestation et justification idéologiques du phénomène, l’idée que chacun est obligatoirement oppresseur ou oppressé. Avec l’interdiction de penser en dehors des normes imposées par les nouveaux dogmes. Cela conduisant, à rebours des auto-déclarations de ses promoteurs, à la haine de l’autre, des autres, ceux accablés de la faute d’être l’oppresseur par assignation préétablie à résidence et à culpabilité indélébile. Oppresseurs ayant privé de leurs droits les autres. Les oppressés devant dorénavant être délivrés à tout jamais de tout devoir, comme de toute responsabilité. Un éventuel salut du présumé oppresseur ne pouvant survenir que dans le cas d’un complet reformatage, d’une restructuration de l’individu ayant avoué ses fautes et s’étant ou ayant été rééduqué. Fantasme et manipulation de l’histoire réécrite à travers l’unique et simplissime couple oppresseur-oppressé, chacun étant pour toujours, ou presque, affecté dans sa case d’origine. Histoire d’ailleurs que l’on veut réécrire pour la tordre en ce sens. Toute ressemblance avec le totalitarisme…
Le tout caché derrière des mots devenus totem, et répétés inlassablement. Des mots vidés, énucléés. Mais obligatoires, parce qu’appartenant au camp du bien. Et d’autres devenus interdits, honteux. Police des mœurs, police de la pensée. Le wokisme est à l’évidence la caricature et l’expression aujourd’hui la plus aboutie de ce dévoiement total du concept de démocratie. Il n’en est en rien une extension. Il n’est pas davantage la prolongation du progressisme. Il est la nouvelle idéologie des excès de la démocratie. Idéologie in fine destructrice de la réalité-même de la démocratie. S’opposer au wokisme, pris comme la radicalisation intolérante et totalitaire du militantisme progressiste, n’est ni du conservatisme, ni une manifestation réactionnaire. La pensée social-démocrate ne peut ni ne doit laisser la critique et le combat contre le wokisme au populisme. Au risque sinon de s’y dissoudre elle-même, jusqu’à disparaître. Et au risque de laisser le populisme être le seul recours contre ces excès-là. L’exemple américain le montre bien (le parti démocrate défait face à Trump jusque dans ses bastions géographiques aussi bien qu’ethniques). En France, le cas du Parti Socialiste d’aujourd’hui en est un exemple également frappant, happé, sauf sursaut délibéré possible, par NFP/LFI, avec le développement du RN en symétrie.
Doivent également et parallèlement être pensés et analysés les excès de la social-démocratie elle-même. Sans omettre que la social-démocratie et la démocratie sont évidemment deux concepts non totalement distincts. Nous les distinguons ici formellement, parce qu’ils ne se résument pas l’un à l’autre, aussi bien que pour faciliter l’analyse. Ses excès, développés aussi de façon endogène, peuvent être résumés dans la recherche de l’égalité poussée à l’extrême. L’égalité totale, parfaite. Pensée magique qui cache une absence de profondeur de pensée. L’égalité en tout, de tous avec chacun, conduit en effet à la jalousie généralisée. Aux passions tristes, donc. Mais aussi bien à la condamnation de ce qui fait la dynamique d’une société, le moteur de l’effort et la recherche de la progression. Partant, de ce qui fait le progrès. Tocqueville : “Il n’y a pas de passion si funeste pour l’homme et pour la société que cet amour de l’égalité, qui peut dégrader les individus et les pousser à préférer la médiocrité commune à l’excellence individuelle.”
La social-démocratie, sans réflexion sur elle-même et sans régulation de ses propres dérives connaît ce genre de glissement fatal. Doivent donc être étayées à nouveau les différences entre égalité « absolue », égalité des droits, égalité des chances et équité. Et leurs conséquences réciproques, morales, économiques et sociales.
Aussi, l’hyper démocratie comme l’hyper social-démocratie induisent-elles des régressions et un potentiel d’extinction progressive de la dynamique des sociétés et des économies, donc du bien-être. Elles conduisent à la faillite financière. Donc à la faillite sociale. Mais aussi, et cela va de pair, elles abîment gravement la capacité de vivre ensemble et de respecter les compromis nécessaires entre liberté et règles. Donc elles amènent à la faillite morale. En laissant les passions les plus basses s’exprimer en toute impunité : la jalousie, le ressentiment, la haine. Elles sont hélas déjà à l’œuvre.
Il n’y aura ni renouveau de la pensée social-démocrate ni diminution de la méfiance actuelle vis-à-vis de la démocratie, sans cet effort d’analyse de la montée naturelle des excès propres à la démocratie et à la social-démocratie et de leur hypertrophie, de la suradministration et de ses effets, de même que du besoin légitime et républicain d’un retour de l’autorité publique et que d’une meilleure régulation et intégration de l’immigration. La montée généralisée du populisme ne trouve certes pas son origine que dans ces facteurs-là. Mais il serait dangereux de nier que son développement a également sa source ici.
Un faux « progressisme » qui cache une vraie régression
La bienveillance comme l’aveuglement devant les causes et les conséquences de ces quatre mouvements ne sont en rien une manifestation de progressisme. Même s’ils se parent de ses vertus. Tout au contraire. Ils enferment. Ils isolent. Ils provoquent de fatales régressions face aux valeurs et d’humanisme et d’universalisme, toujours valeurs de progrès, de responsabilisation et d’émancipation, comme de recherche d’harmonie. Valeurs jamais parfaitement réalisées, certes. Mais elles ont malgré tout permis que l’humanité, dans certaines civilisations, a pu reconnaître et respecter les minorités. Et ce, sans que cela se fasse au détriment de la majorité (principe démocratique sinon déformé outrageusement et dangereusement). Ces valeurs ont conduit également à reconnaître l’égalité des races, des sexes, des origines sociales… Elles ont aussi facilité l’égalité des chances et non plus une assignation à la naissance de par l’appartenance des parents à telle ou telle caste, par exemple. La combinaison du trop d’Etat avec l’hyper démocratie et l’hyper social-démocratie engendre ce mal pernicieux et destructeur dont la résolution ne se fait que dans la montée sans limites des droits et dans l’affaissement des devoirs et des responsabilités. Comme dans la perte d’efficacité de la régulation economico-sociale.
Et, partant, dans la perte de confiance sociétale, une méfiance vis-à-vis des institutions, de la politique et des autres, donc vis-à-vis de la société elle-même.
Et, in fine, par une croissance sans fin, insoutenable, de la dette publique.
Pour que le système d’une société dotée d’une économie sociale de marché puisse perdurer, la réassurance, notamment pour les plus démunis et les accidentés de la vie ou de la conjoncture, d’une protection indispensable apportée par la société, c’est-à-dire, pour l’essentiel, par la sphère publique dans une société moderne, doit se marier de façon équilibrée avec la responsabilité individuelle, familiale, comme des groupes autonomes de personnes, L’Etat Providence, certes. Mais il ne peut, ni ne doit, sous peine d’entropie, chercher à protéger de tout, sans limite. Et au prix d’une déresponsabilisation vis-à-vis d’eux même comme vis-à-vis des autres des membres qui composent la société. Tocqueville encore : “Le souverain étend ses bras sur la société tout entière; il en couvre la surface d’un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie, et les dirige; il ne tyrannise pas, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n’être plus qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger.”
La survie du modèle d’économie sociale de marché
La juste combinaison, c’est-à-dire l’équilibre viable, est pour le moment rompu. Mettant en danger l’Etat Providence lui-même, et partant, la protection sociale qui est un bien précieux. La critique de l’administration est de tout temps, nous en convenons aisément. Mais la présente analyse interroge la capacité de la démocratie et de la social-démocratie, et de façon intimement liée la sphère publique, à ne pas tomber dans l’entropie et à se stabiliser à un point d’équilibre qui marie durablement l’éthique (ou la justice) et l’efficacité (la production de richesse) et le bien-être économique et social.
Il s’agit donc là d’une question de survie de notre modèle économico-social européen. Avec ses défauts spécifiquement français, rendant le système de plus en plus inefficient, notre modèle de régulation sera tôt ou tard incapable de se reproduire, c’est à dire de survivre. Avec pour corollaires, si le sursaut ne vient pas à temps, un appauvrissement généralisé et une déconfiture morale et financière.
La réflexion doit donc se poursuivre. Comment induire des mécanismes de limitation de ces excès? Comment retrouver les équilibres vitaux qui permettent à nos sociétés de survivre et de se revigorer?
C’est tout l’enjeu. C’est une question fondamentale pour notre avenir, notre « modèle », notre Europe et notre pays.
[1] Marc Guillaume, PUF
[2] L’atomisation des individus, comme la perte de sens vis-à-vis de la collectivité et de la société, est évidemment également due au développement des réseaux sociaux qui en outre véhicule des informations fausses ou vraies qui dénaturent le rapport à la vérité et renforce l’individualisme. Jusqu’à favoriser, de même que l’Etat omniprésent, la montée du populisme. Mais les ressorts en sont différents et l’analyse ne peut les confondre.