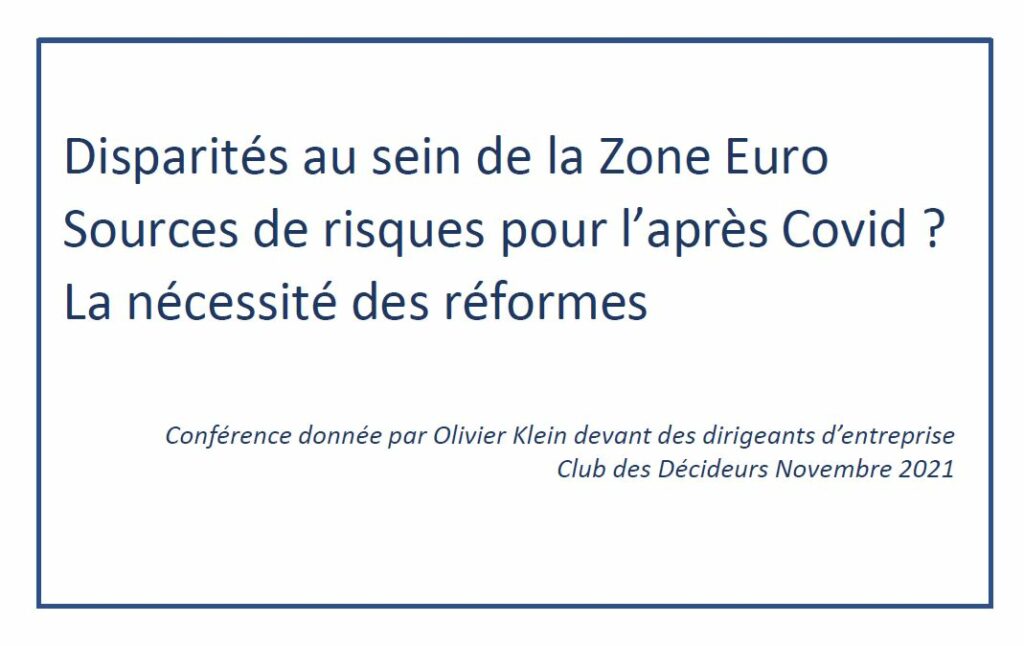Les taux d’intérêt resteront-ils durablement inférieurs au taux de croissance, comme si la dette n’avait pas d’importance ? On peut penser, au contraire, que les banques centrales vont initier ou continuer une augmentation progressive de leurs taux. Quelles seront alors les réactions possibles et pertinentes pour un État connaissant un niveau d’endettement élevé ?
Avant la toute récente guerre en Ukraine, la croissance était forte, même si elle déclinait légèrement eu égard au lent retour vers un taux de croissance plus normal après le rebond de 2021. La politique monétaire devait donc être a minima normalisée, sans à-coup du fait du fort endettement global et de marchés financiers et immobiliers très fortement valorisés, en sortant progressivement de la politique d’assouplissement quantitatif (quantitative easing), ainsi qu’en remontant prudemment les taux. Cette nécessité de resserrement venait du risque de surchauffe. Mais aussi du risque d’épuisement de la politique monétaire en cas de nouvelle crise future (et il y en a toujours). Enfin, du développement des bulles dues aux taux trop longtemps trop bas par rapport aux taux de croissance.
Puis est venu, il y a plusieurs mois, un regain d’inflation. Force a été de constater qu’une partie de cette inflation n’était pas transitoire et que l’on était probablement en train de changer de régime inflationniste. La Fed, puis la BCE, ont ainsi été conduites à accélérer leur annonce d’arrêt progressif de leurs achats nets de titres sur les marchés. Elles ont également déclaré qu’elles allaient remonter leurs taux un peu plus vite que prévu. Pour les mêmes raisons que celle décrites ci-dessus, l’enjeu était alors cependant toujours de ne pas aller trop vite dans la sortie de leur politique très accommodante. La BCE devait en outre faire face à la question plus spécifique et plus délicate de la zone euro, avec ses forts déséquilibres entre pays du Sud et pays du Nord.
Dans le même temps, les États avaient, et ont toujours, un besoin d’investissement pour le développement des nouvelles technologies, la réindustrialisation (même partielle) et la transition énergétique. Il existait donc un conflit entre, d’un côté, l’objectif de stabilité financière mise à mal par des taux d’intérêt trop bas pendant trop longtemps et désormais de lutte contre l’inflation et, de l’autre, celui du financement des nouveaux investissements nécessaires et de solvabilité des États, voire d’acteurs privés, dont l’endettement s’était fortement accru depuis 2000 pour le secteur privé et depuis 2007 pour le secteur public, avec en outre un renforcement significatif de l’endettement public dû à la pandémie.
D’où la montée de plusieurs voix en zone euro. Les uns énonçaient la nécessité de changer les règles budgétaires communes, en excluant du calcul des contraintes imposées sur les déficits publics les budgets d’investissements. Cette proposition étant doublée parfois de l’idée que, dans les circonstances actuelles, le niveau de dette publique avait peu d’importance, et que les banques centrales continueraient de financer longuement les futurs déficits. D’autres montraient un chemin plus étroit, mais me semble-t-il bien plus crédible, expliquant certes la nécessité de changer les règles communes de la zone euro, datées et peu efficaces, mais soulignant dans le même temps l’importance des compromis à trouver entre les pays du Nord et les pays du Sud sur ces changements de règles pour ne sélectionner comme candidats à l’exclusion que les investissements effectivement porteurs de croissance potentielle ou facilitant la transition énergétique. Toute dépense n’entraînant en effet pas toujours plus de croissance potentielle. Et l’amélioration du potentiel de croissance ne nécessitant pas toujours un surcroît de dépense. Il était également crucial, dans cette optique, de se mettre d’accord sur des règles budgétaires raisonnables, empêchant tout comportement de « passager clandestin ».
Le spectre de la stagflation
Aujourd’hui, la situation de guerre a engendré le spectre de la stagflation. Donc d’un ralentissement de la croissance qui sera d’au moins un point, ainsi que d’une inflation encore beaucoup plus forte que prévue avant le début de la guerre. Cela provoquera ainsi un dilemme encore plus intense pour les banques centrales. Mais, si le très vif regain d’inflation ne conduisait à aucune réaction ou à une réaction très faible de leur part, un risque majeur d’emballement de l’inflation pourrait survenir. Car aujourd’hui, la question de savoir s’il y aura un second tour de l’inflation ne se pose plus. Beaucoup d’industriels et de grands distributeurs augmentent leurs prix, ne pouvant plus contenir l’augmentation de leurs coûts. Et nombre d’entreprises ont commencé à augmenter leurs salaires. Elles ne peuvent en effet pas agir autrement, si elles souhaitent conserver leurs compétences ou être en mesure de recruter. Les prochaines négociations salariales renforceront ce phénomène.
Or, si l’inflation s’installe par les indexations des prix aux prix, des salaires aux prix et des prix aux salaires, avec une croissance ralentie, nous entrerons bien dans une dynamique stagflationniste potentiellement durable. Lorsque Paul Volcker, alors président de la Fed, a tenté en 1979 de sortir d’une longue stagflation, il lui a fallu provoquer une profonde récession pour parvenir à casser les phénomènes d’indexation. Faire fi de l’inflation serait également très dangereux en termes d’inégalité, car personne n’est égal, ni chez les salariés ni chez les entreprises, devant la capacité à répercuter dans ses revenus les augmentations subies des prix. Il faut de surcroît redouter une inflation qui puisse se transformer en un système tendant vers l’hyper-inflation, faisant perdre leurs repères aux agents économiques. Une inflation stable et basse permet des accords salariaux viables ; des catalogues de prix fiables entre les producteurs, les distributeurs et les consommateurs ; des contrats de prêt permettant de fixer les taux d’intérêt entre emprunteurs et prêteurs fondés sur une anticipation d’inflation partagée. Bref, une inflation stable et suffisamment basse est essentielle à la confiance. Or cette dernière est nécessaire à une économie efficace. La politique monétaire doit donc réagir à temps. Si elle ne le faisait pas, elle devrait agir plus tard en prenant beaucoup plus de risque. Les banques centrales doivent rester crédibles. En soutenant la croissance certes, mais en luttant clairement contre l’inflation. D’ailleurs, une inflation non contrôlée mine la croissance elle-même.
Un chemin étroit
Ce chemin sera très étroit. La politique de resserrement monétaire doit donc nécessairement être très prudente, donc très progressive. Cette trajectoire nécessitera de ce fait impérativement que les gouvernements également jouent bien leur partition. Ces derniers devront réaliser d’un côté les investissements nécessaires, porteurs de croissance potentielle, et de l’autre réduire les dépenses non nécessaires ou les réallouer utilement. En France, nous affichons depuis longtemps des dépenses publiques par rapport au PIB les plus élevées au sein de la zone euro ; pourtant sur certains domaines ces dépenses ne procurent depuis quelques décennies qu’une qualité très peu en rapport avec le niveau des dépenses réalisées. Les nombreuses mesures comparatives de l’OCDE en attestent très régulièrement. Ainsi, l’effort ne doit-il pas être que financier. Les investissements indispensables ne pourront donc se faire que si les réformes indispensables sont conduites. Comme celle de la retraite, qui tout en réduisant le déficit public soutient la croissance potentielle car elle accroît la population disponible au travail, alors qu’actuellement la France fait partie des États qui ont le taux d’emploi après 60 ans significativement le plus faible.
Au total, il est impératif que les banques centrales neutralisent, a minima, mais prudemment, leur politique monétaire, pour lutter contre un trop fort surcroît d’inflation, comme pour éviter une instabilité financière due à des bulles qui se développeraient encore. Et, simultanément, il est indispensable que les gouvernements augmentent la croissance potentielle par des investissements et des réformes et assurent un meilleur contrôle des dépenses. Afin de donner des trajectoires crédibles à leur politique budgétaire et assurer leur solvabilité dans un monde où les taux d’intérêt seront structurellement en hausse.
Le 16 mars de cette année, la Fed a augmenté son taux d’intervention de 25 centimes et donné à comprendre que les hausses à venir seraient nombreuses. La BCE, le lendemain, à son tour a annoncé un arrêt de ses achats nets de titres à fin juin et ouvert la porte à des hausses de taux ultérieures. Qui plus est, si la BCE ne conduisait pas un tel changement de politique, l’euro continuerait de se déprécier notamment contre le dollar, conduisant à une inflation encore plus forte, due à la hausse de prix en euro des produits importés. Le mouvement semble donc lancé.
Les impensés de l’«économie de guerre»
L’idée d’une « économie de guerre », guerre contre le changement climatique, guerre pour la réindustrialisation, comme guerre militaire, telle qu’elle commence à être évoquée ici et là chez certains économistes – si elle conduisait à penser que la dette n’avait pas d’importance et que les banques centrales seraient conduites à financer tout nouveau déficit permettant ainsi de dépenser très durablement sans contrainte – pourrait conduire à un désastre. Ce concept d’économie de guerre induit inéluctablement l’idée d’une durée très longue. Contrairement à un « quoi qu’il en coûte », limité à la durée de la pandémie. Or cette idée comporte un impensé : la monnaie. La monnaie est le fondement du système de règlement des dettes. Avoir confiance dans la monnaie c’est avoir confiance dans l’efficacité du système de règlement des dettes. De ce fait, si jamais la contrainte monétaire[1] était suspendue trop longtemps, alors ce serait la confiance dans la monnaie qui pourrait être remise en cause. Et si l’on n’avait plus la confiance dans la monnaie, nous pourrions connaître, non pas une inflation traditionnelle, mais une fuite devant la monnaie. Si les banques centrales ne cessaient jamais de faire du « quantitative easing » et maintenaient sans fin des taux trop bas par rapport au taux de croissance, non seulement se produiraient régulièrement de graves explosions financières, mais également tôt ou tard serait engendrée une fuite devant la monnaie qui serait dramatique. Avec pour conséquence la désorganisation et l’effondrement de l’économie et de la société. Car la monnaie est constitutive du lien social. Comme le dit Michel Aglietta : « la confiance dans la monnaie, c’est l’alpha et l’oméga de la société ».
[1] Soit l’obligation de payer ses dettes ou plus exactement, pour les Etats et les entreprises, de devoir les refinancer à leur terme auprès des prêteurs autres que les banques centrales.