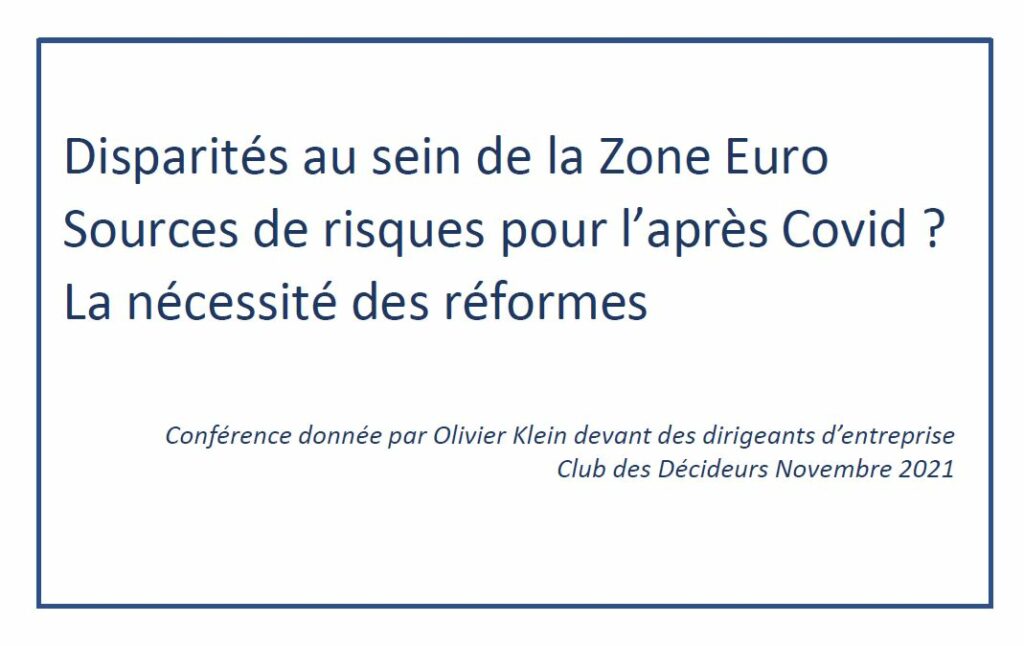Comment bâtir une zone monétaire efficace par un projet réel de solidarité dans l’Union ? La réponse à la pandémie a permis des percées, mais beaucoup reste à faire. Des efforts tout à la fois individuels – pays par pays – et communs de la part des membres de l’Union, y compris transitoirement du Nord vers le Sud, sont nécessaires.
Une union monétaire est en principe très efficace lorsque la croissance y est facilitée par le fait que les capacités de financement de certains pays de cette union permettent de répondre aux besoins de financement des autres, repoussant ainsi la contrainte extérieure aux bornes de la zone monétaire et non aux frontières de chacun des pays la composant. C’est par exemple le cas aux Etats-Unis d’Amérique pour les différents Etats qui les constituent. Une croissance durablement plus forte de la Californie, par exemple, ne serait ainsi pas freinée par la moindre croissance des autres Etats, même si cela entraînerait un déficit courant croissant du premier Etat vis-à-vis de l’ensemble des autres, parce que le seul solde de la balance courante pertinent n’est que celui des Etats-Unis dans leur ensemble et non de celui de chacun des Etats. Il faut donc que les capitaux circulent efficacement au sein d’une union monétaire. Et pour que cette circulation puisse se faire sans frein, il faut une union de transferts, c’est-à-dire des éléments de solidarité budgétaire entre les Etats.
La crise de la zone euro, qui a démarré en 2010, a été une crise de « sudden stop », spécifique à cette zone, et non pas le simple rebondissement de la grande crise financière précédente. Jusqu’alors, les marchés financiers avaient très bien fait correspondre les capacités de financement des pays du Nord aux besoins de financement des pays du Sud au sein de la zone euro. Pourtant, des divergences de plus en plus grandes entre les soldes des balances courantes des pays de la zone, soit des déficits et des excédents croissants des uns et des autres, étaient apparus depuis la naissance de l’euro. Et lorsque les marchés ont compris qu’il n’y avait en réalité pas de mécanisme de solidarité entre les pays de la zone, ils ont soudainement cessé d’allouer les capacités de financement des pays du Nord – c’est-à-dire les excédents de leur balance courante – aux besoins de financement dus aux déficits courants des pays du Sud. La crise est donc survenue précipitamment, comme à chaque fois que les marchés financiers découvrent brutalement, et souvent tardivement, la réalité telle qu’elle est. Les pays structurellement plus importateurs qu’exportateurs, voyant leurs financements extérieurs coupés par les marchés et ne bénéficiant pas de solidarité de la part des autres pays de la zone, ont été obligés de freiner immédiatement leur demande, donc leurs importations, par une baisse des investissements, des salaires, des prestations sociales et des dépenses publiques. Par de fortes politiques d’austérité, les pays du Sud ont ainsi amené rapidement les soldes de leur balance courante à des niveaux proches de zéro. Les pays du Nord, restés en fort excédent courant, se sont mis à financer le reste de la planète, et notamment les déficits courants américains, mais paradoxalement pas les autres pays de la zone euro elle-même. Ce qui, à proprement parler, ne correspond en rien à une affection efficace des capitaux au sein d’une union monétaire.
Il est donc désormais important de se demander comment bâtir une zone monétaire efficace par un projet réel de solidarité dans l’Union. Les améliorations « techniques » espérées tant du marché européen des capitaux que de l’Union bancaire ne sauraient le permettre à elles seules.
Depuis la crise idiosyncratique de la zone euro, les seuls éléments qui ont permis d’intermédier partiellement les capacités de financement des uns avec les besoins de financement des autres sont venus de la Banque centrale européenne, à travers ses relations avec les banques centrales nationales de la zone (Target 2). Ce sont donc les banques centrales qui en réalité ont fait circuler les capitaux, mais indépendamment des marchés. Puis, avec l’apparition de la pandémie de COVID-19, sont nés le plan Next Generation EU et l’emprunt communautaire, qui permettent aujourd’hui d’entrer dans une nouvelle dimension car ils créent des éléments clairs de solidarité et une meilleure circulation des capitaux. Pour la première fois dans l’histoire de la zone et en réalité de l’Union européenne, des dépenses communautaires, à travers des dons, mobilisent des montants incomparablement plus forts que précédemment, tout en ne se répartissant pas en fonction du poids relatif de chaque pays mais en fonction de leurs besoins. A condition toutefois qu’ils engagent les réformes nécessaires. Et le financement de ces dons se fait par un emprunt communautaire. Il y a bien là des manifestations évidentes de solidarité.
Naturellement, la question qui en découle est celle des futures ressources propres à l’Union européenne, indispensables pour rembourser ces emprunts. L’enjeu est alors de savoir si les pays européens vont parvenir à se mettre d’accord sur des taxes communes, telles que sur le plastique, le CO2 ou le numérique. Et si ce budget et cet emprunt communautaires seront durables. Le «moment hamiltonien» de l’Europe n’en sera véritablement un que s’il y a durablement des dépenses communes de montants importants, une dette communautaire et des ressources propres à l’Union européenne, et non seulement en réponse à la pandémie. La solidarité sera-t-elle durable ou sera-t-elle, comme beaucoup de pays du Nord l’évoquent déjà, un « one off », une opération isolée, propre à la pandémie ?
Une union monétaire ne peut être durable que s’il y a des éléments clairs d’une union de transferts. Ainsi, la question fondamentale est-elle de savoir si les intérêts des différents pays européens sont suffisamment convergents pour y parvenir et y consentir durablement. S’ils ne le sont pas, il devient très difficile d’assurer la permanence d’un budget et d’une dette communautaires.
Or les pays du Nord ont significativement accru leur capacité industrielle pendant que les pays du Sud se sont progressivement désindustrialisés depuis la création de la zone euro. Consécutivement, les pays du Nord ont gagné des parts de marché dans le commerce mondial (augmentation de leurs exportations en pourcentage des exportations mondiales), alors que les pays du Sud, eux, en ont perdu. Les pays ayant des excédents courants, donc les pays du Nord, ont ainsi accumulé des avoirs nets sur le reste du monde ; tandis que les pays du Sud, en déficit courant, jusqu’à la crise de la zone euro, ont à l’inverse en permanence accumulé des dettes vis-à-vis du reste du monde. Parallèlement, les évaluations des niveaux d’éducation initiale, comme des aptitudes professionnelles, sont très différentes entre pays du Sud et pays du Nord. Comme les taux de chômage des jeunes ou les taux d’emploi, les gains de productivité divergent également. Or tous ces facteurs contribuent au niveau de croissance et à la compétitivité qualité/prix de chaque pays. Ajoutons enfin que les conséquences en sont une divergence Nord-Sud de plus en plus grande dans les niveaux de dette publique sur PIB. Si cette situation perdure ainsi, la solidarité post pandémie risque de faire long feu. D’autant qu’en outre l’inflation actuelle, si elle n’était pas que transitoire, conduirait la BCE à augmenter ses taux progressivement, pour neutraliser sa politique à tout le moins, voire d’avantage, ce qui accroîtrait les difficultés des pays du Sud n’ayant pas encore suffisamment engagé une politique crédible de normalisation de leur politique budgétaire. Ou, au contraire, pour protéger ces derniers, à ne pas augmenter les taux, ce qui aggraverait considérablement les tensions des pays du Nord vis-à-vis d’une politique monétaire unique considérée alors comme trop longuement accommodante. Cela provoquerait sans doute aussi des réactions dangereuses des marchés.
Face à ces fortes et nombreuses divergences, que faut-il alors construire pour obtenir plus de solidarité ? Comment faire pour établir une confiance réciproque entre les pays du Nord et les pays du Sud ? Trois points peuvent ici être avancés.
En premier lieu, les pays du Sud doivent réaliser des politiques structurelles, c’est-à-dire des investissements ad hoc et des réformes visant à réduire significativement ces divergences. Ces indispensables réformes ne sont pas des politiques d’austérité puisque, bien au contraire, elles permettent d’augmenter la croissance potentielle, par l’accroissement de la productivité, l’amélioration de l’efficacité de la formation initiale comme professionnelle, par une meilleure mobilisation du travail, y compris par la réforme des retraites, comme par une optimisation des dépenses publiques. Seules ces politiques garantiront aux pays du Nord de ne pas devoir envoyer indéfiniment des subsides aux pays du Sud. Ce qui permettra ainsi d’enclencher des éléments nécessaires pour aboutir à une union de transferts.
Ces réformes sont certes nécessaires, mais elles ne seront pas suffisantes. Les politiques structurelles seules ne permettront en effet pas de rattraper les différences accrues de niveaux d’industrialisation entre les pays du Nord et du Sud. D’où le deuxième point : une politique industrielle et d’aménagement du territoire dans l’Union européenne doit également être menée, à travers des investissements et des aides des pays du Nord vers les pays du Sud, pour contribuer à leur réindustrialisation dans certains secteurs bien choisis. Sur ce point, on peut espérer que le plan Next Generation EU soit capable d’apporter des réponses, car ce plan présente et porte en lui des projets d’avenir structurants. Il faudrait donc qu’ils puissent être mis en place en fonction des spécialisations relatives existantes ou souhaitables, de façon à favoriser, dans les pays le nécessitant, industrialisation et compétitivité.
Enfin, le troisième point repose sur la nécessaire reconstruction de règles budgétaires partagées et réalistes; elles ne le sont plus aujourd’hui. Ces règles doivent être efficaces et permettre précisément d’accompagner ces évolutions, tout en faisant en sorte qu’il n’y ait pas de passager clandestin au sein des pays de l’Union.
Des efforts tout à la fois individuels – pays par pays – et communs de la part des membres de l’Union, y compris transitoirement du Nord vers le Sud, sont ainsi nécessaires. Car ces efforts permettront, dans un intérêt bien partagé, au Nord de ne pas financer le Sud ad vitam aeternam, et au Sud de ne pas vivre une désindustrialisation continuelle avec tout ce que cela implique tant économiquement que socialement. Et il faut des règles budgétaires qui permettent de mettre en place efficacement ces politiques. Ces mêmes règles doivent aussi ne pas laisser la possibilité pour certains pays de compter sans fin sur l’aide des autres, en différant perpétuellement les réformes nécessaires. Dans le cas contraire, soit le populisme continuerait de monter dans les pays du Nord qui n’acceptent pas l’idée de verser des subsides à l’infini au pays du Sud, soit le populisme monterait encore dans les pays du Sud, si on les laisse continuellement se désindustrialiser sans leur venir en aide. D’autant que cette désindustrialisation est favorisée par une union monétaire incomplète, c’est-à-dire notamment sans coordination des politiques économiques et sans union de transfert. Le rattrapage des différentiels de compétitivité ne peut en effet être facilité par des dévaluations – qui ne sont cependant jamais des solutions miracle -, ce qui entraîne une dynamique d’écarts de compétitivité croissants, avec des phénomènes induits de polarisation industrielle localisée dans les pays ayant le plus d’avantages comparatifs.
Sans efforts nationaux et communautaires donc, il sera impossible de parvenir à des éléments de solidarité pour sortir de ce piège. Nous subirions alors cette montée du populisme qui finirait par mettre en réel danger l’Union monétaire, Union monétaire qui constitue un bien commun indéniable, de par les vertus de l’euro qui nous a prouvé sa forte utilité notamment pendant les crises, grâce à l’action déterminée de la Banque centrale européenne. Or, la banque centrale européenne ne pourra éternellement pallier l’incomplétude de la zone euro.