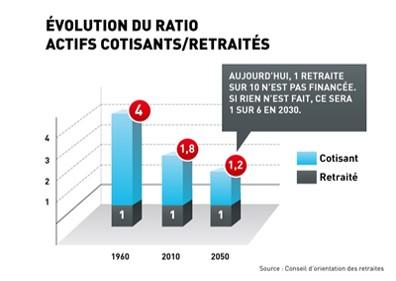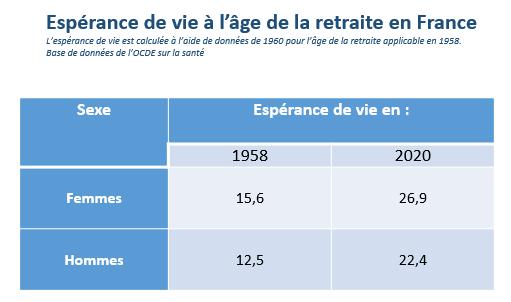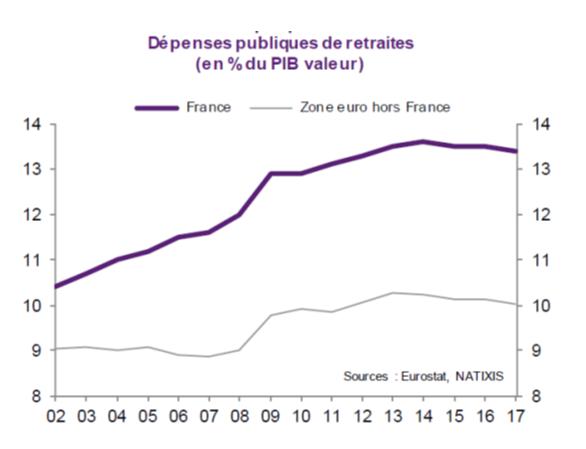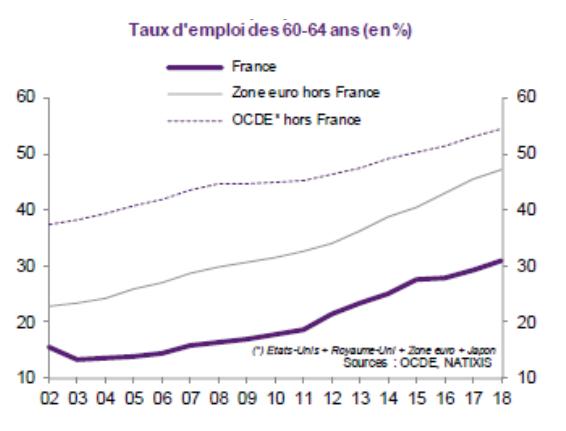En réaction à l’article de Nicolas Véron publié par le Peterson Institute et disponible ici : https://www.piie.com/sites/default/files/documents/sarsenbayev-veron2020-04.pdf
La Chine, sous la présidence de Xi Jinping, a re-concentré les pouvoirs dans les mains d’un nouveau grand timonier, qui impose une forme de capitalisme totalitaire au sein de son pays, à base d’un contrôle social extrêmement poussé et favorisé par les nouvelles technologies, associé à une économie fondée sur le développement du capital et des richesses sans beaucoup de limites.
Elle a lancé une vaste opération extérieure de sécurisation de nombreuses ressources naturelles dans des pays tiers, d’influence diplomatico-politique tous azimuts et d’investissement dans des infrastructures certes, mais au prix d’un surendettement assez général des pays en ayant bénéficié. Car il n y a pas de dons dans cette stratégie de conquête, mais des prêts à des taux d’intérêt qui n’ont rien de comparables à une aide au développement.
En outre, elle exerce le plus souvent ainsi une mise en dépendance notable des gouvernements des pays dans lesquels elle investit, par divers moyens, dont ceux de l’endettement.
Cette stratégie globale de conquête appuie la volonté du pouvoir chinois de devenir la première puissance mondiale en 2049, qui sera comme on le sait l’année du centenaire de la révolution chinoise.
Et son attitude vis-à-vis de l’Europe ne diffère pas dans son essence de celle qu’elle adopte pour les pays n’appartenant pas à l’OCDE. Elle ne traite pas avec l’Union, mais avec ses pays les plus en difficultés, en les réunissant autour de leur relation avec la Chine elle-même, redécoupant ainsi la géographie européenne, et en ignorant son organisation institutionnelle. Il est d’ailleurs frappant de constater que la plupart des pays ainsi réunis par elle mettent le plus souvent un veto aux propositions européennes de prise de mesures visant à ce que l’Union puisse traiter davantage d’égale à égale avec la Chine et puisse se donner les moyens de rechercher un équilibre et une symétrie dans les relations économiques et commerciales entre les deux parties.
La nouvelle route de la Soie annonce que son objectif est d’apporter plus de développement à des pays qui en ont besoin. Ce qui est une vérité aussi, même si elle est partielle. Les Chinois construisent des infrastructures nécessaires à ces pays, comme au développement du commerce dans le monde. Ils le font sans intervenir officiellement sur la façon dont les pays se gouvernent.
Mais s’ils affichent volontiers un non-interventionnisme politique, la nouvelle route de la soie leur permet de développer ainsi leur zone d’influence, en construisant pour nombre de pays « bénéficiaires » une dépendance vis-à-vis d’eux-mêmes.
Et cette zone d’influence, qui s’élargit alors considérablement, comprend également un objectif économique marqué.
La Chine crée elle-même, grâce à la route de la soie, des débouchés pour ses propres industries, qui sont très souvent en surcapacité. Il leur faut trouver des zones de développement. Ils soutiennent également ainsi l’internationalisation de leurs entreprises dans un jeu de go et renforcent les grandes entreprises chinoises par là même en étendant leur marché. Seules les entreprises chinoises, ou presque elles seules, obtiennent les marchés très nombreux ouverts par la nouvelle route de la soie. Ces entreprises diffusent, en outre, de cette manière les normes et les standards chinois à l’extérieur de la Chine pour y favoriser demain son implantation et s’y rendre incontournable. Sans même parler éventuellement des outils modernes du contrôle de l’information, publique ou privée.
La route de la soie soutient donc la croissance chinoise par une expansion à l’étranger, dans un contexte économique intérieur où les Chinois doivent trouver de nouveaux relais de croissance, en étendant la zone d’influence chinoise et en le transformant en un nouveau marché intérieur, afin de ne plus fonder leur croissance uniquement sur la demande extérieure, c’est-à-dire sur leurs exportations.
La Chine a également l’intention, je l’ai cité plus haut, et cela se voit dans de très nombreux pays où elle investit, de sécuriser son accès aux matières premières et aux ressources énergétiques.
Complémentairement, je pense que, dans leur stratégie, existe une volonté de désenclaver certaines provinces chinoises en accédant à des pays périphériques et riverains, et en les stabilisants, de façon à préserver aux alentours un environnement le plus stable possible.
Cette stratégie globale d’expansion est également portée par un grand rêve chinois, celui d’effacer – et cela me paraît très fort dans leur façon d’agir – l’humiliation des comptoirs.
La Chine a vécu, au XIXe siècle, une défaite sur mer et l’implantation des étrangers dans une économie de comptoir. Les Chinois ont été interdits dans certains endroits, en Chine même, de par un apartheid intolérable. On le comprend aisément, cela a été vécu par eux jusqu’en 1949, leur révolution, comme une humiliation insupportable. Dans le fond, c’est aussi – et le président Xi Jinpig le dit très clairement – la renaissance d’une grande nation chinoise, que porte aussi le peuple chinois lui-même, au-delà du parti communiste et de ses représentants au pouvoir.
La nouvelle route de la soie est ainsi l’expression de l’ambition de la Chine à retrouver sa place, celle de l’empire du Milieu. Pour se retrouver au centre du jeu mondial. D’ailleurs, lorsqu’on considère les cartes géographiques représentées par les Chinois, c’est assez passionnant. Nous avons souvent des cartes géographiques conçues par les Européens. Sur les cartes géographiques réalisées par les Chinois, la Chine est au centre, et l’on voit très bien de ce fait se dessiner la nouvelle route de la Soie, « One Belt, One Road ».
Ma question, mon dernier point, est : quels peuvent être les dangers de cette stratégie ? Quel peut être le jeu de l’Europe dans ce nouveau jeu multipolaire et face au développement de cette Chine qui joue si bien au jeu de go ? Quand on joue bien au jeu de go, on entoure les autres, et petit à petit on devient dominant, même si on ne détruit pas l’autre.
Le danger serait un monde bipolaire, avec d’un côté, une Chine qui constitue progressivement sa zone d’influence, sans guerre jusqu’alors, l’« empire » du milieu ne procédant pas d’un impérialisme très 19ème siècle. Ce qui ne l’empêche en rien d’être très prégnant. Et très loin des valeurs démocratiques et des règles du jeu européennes. Et, de l’autre, les États-Unis, pour une autre partie du monde, qui laissent d’ailleurs beaucoup de place à cette nouvelle influence chinoise, notamment en Asie, dans le Pacifique et en Afrique, de par leur propre désengagement.
En arrivant au pouvoir, le nouveau président des États-Unis a commencé par sortir de l’accord Trans-Pacifique, qui était pourtant pour beaucoup de pays localement une façon de ne pas dépendre uniquement de la Chine. En agissant ainsi, il a précipité de nombreux pays dans les bras de la Chine. Les États-Unis, en réalité, investissent peu dans ces pays, alors que la Chine y investit beaucoup. Inutile de dire que nombre de ces pays n’ont pas tellement le choix de leur alliance.
La question qui m’inquiète un peu est la place de l’Europe. Il faut trouver un jeu intelligent pour l’Europe, une stratégie que j’appellerais dialectique pour ne pas laisser se former simplement une zone d’influence américaine et une zone d’influence chinoise se partageant le monde.
Comme je l’ai dit, la Chine cherche aussi l’Europe, mais quand elle intervient en Europe à travers la nouvelle route de la Soie, elle intervient non de façon multilatérale, mais seulement par le biais d’une partie des pays européens, pas avec l’Union européenne en tant que telle. Elle travaille essentiellement avec les anciens PECO en Europe de l’Est et dans les Balkans, sur des bases bilatérales. Plus récemment avec l’Italie et le Portugal.
Elle ne travaille pas avec l’ensemble organisé européen qui le réclame pourtant. C’est aussi le problème de l’Europe elle-même qui est trop faible dans sa capacité de décision et de cohésion, et qui de ce fait ne représente pas un interlocuteur suffisamment valable.
L’Europe pourrait donc sans doute jouer un jeu dialectique, qui ne serait ni celui des Américains ni celui de la Chine, tout en ne les excluant pas, et être utile à l’ensemble des parties, y compris à l’Europe elle-même. D’ailleurs, la France est intéressante pour les Chinois, à cause de l’Afrique. Beaucoup d’étudiants chinois viennent en France aussi pour apprendre à comprendre l’Afrique et à y travailler ensuite.
L’Europe pourrait, pour les pays tiers, desserrer l’étau qui les enserre entre les différentes puissances agissant sur place. L’Europe y est toujours associée à l’idée d’un ensemble aimable et recherché, mais associant des pays manquant de capacité à agir de conserve et, au total, elle y est vue comme ayant une puissance d’investissement très modérée. En outre, peu capable de s’unir pour être plus concentrée et plus forte.
Notre Europe doit donc sortir d’une certaine naïveté tactique, d’une naïveté morale – comme le disait Peguy du Kantisme, (l’Europe) « a les mains pures, mais n’a pas de mains du tout »-, se doter d’une puissance stratégique et s’imposer en exerçant des rapports de force indispensables, appuyée sur sa puissance économique, son marché intérieur et ses valeurs, dans un jeu mondial qui depuis des années se construit sans elle. Europe stratège ou Europe puissance, je ne sais. Peu importe les mots.
Mais les Nations européennes ne parviendront jamais à se hisser à cet impératif catégorique, qui conditionne sa place dans le monde, si elle ne peut s’entendre aujourd’hui, au sein de ses propres membres, dans la terrible crise pandémique, économique et financière que nous vivons, sur le juste et nécessaire compromis entre responsabilité et solidarité.
J’espère que ce bien modeste commentaire suscitera d’autres analyses et critiques.