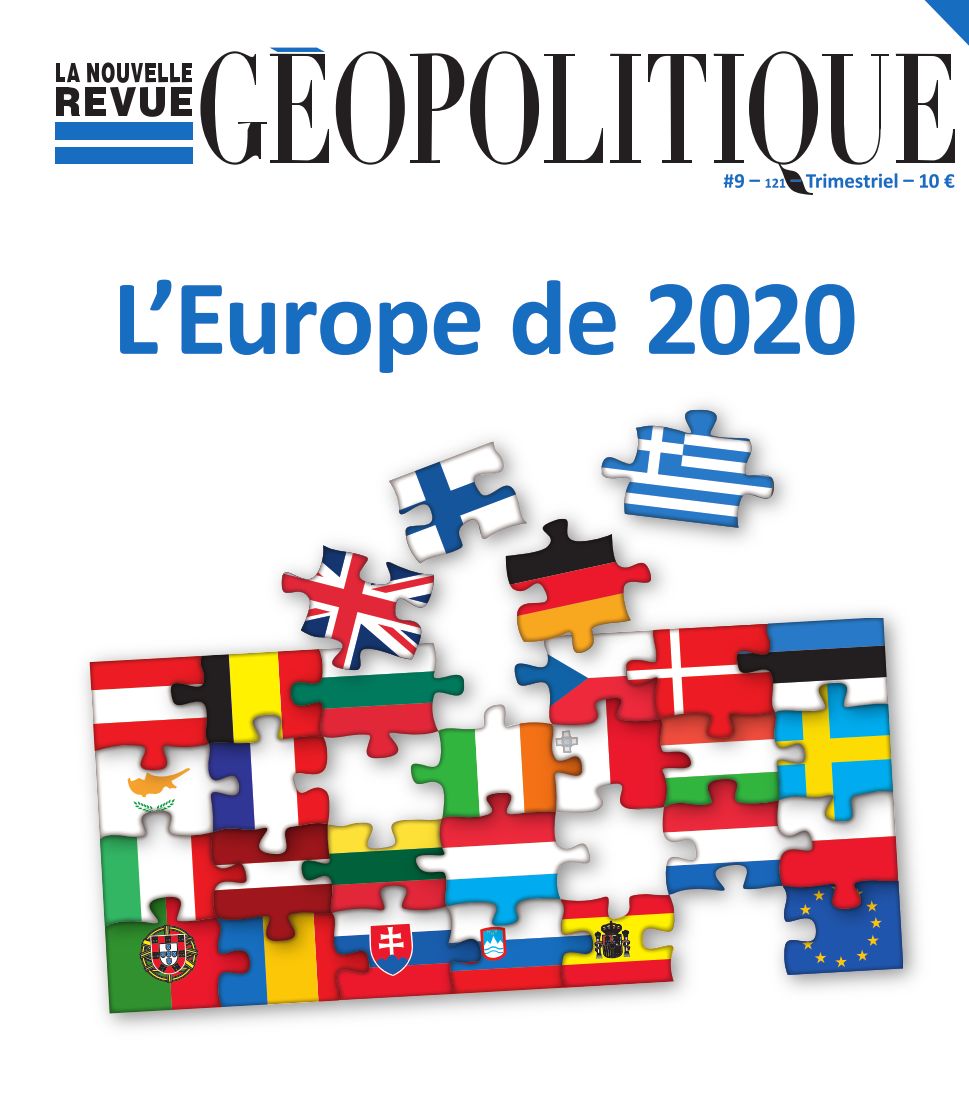Un regard sur le passé tout d’abord. Le Système monétaire européen (SME) a été mis en place pour créer un lien fixe, mais ajustable entre les différentes devises de la zone. Il permettait ainsi, depuis 1979, d’éviter les variations brutales et perturbantes entre les devises des différents pays constituant le SME. Cependant, s’il démontrait sa forte utilité, il restait une source d’instabilité : des événements externes pouvaient entraîner des chocs asymétriques non désirés entre les pays européens concernés. Par exemple, une baisse du dollar contre les autres monnaies conduisait les opérateurs de marché à se porter sur le deutsche mark. Ils faisaient ainsi monter la devise allemande contre le dollar, mais aussi contre le franc français ou d’autres monnaies du SME. Cependant, l’évolution conjoncturelle de la France ou des autres pays et de l’Allemagne ne nécessitait pas une telle évolution du cours de change entre leurs devises.
En outre, chaque pays de la zone conservant sa monnaie, le solde de la balance courante devait être surveillé pays par pays. Une nation qui avait besoin de plus de croissance économique – par exemple de par sa plus forte croissance démographique – venait régulièrement buter sur la contrainte extérieure : un différentiel de croissance économique entre deux pays engendrait mécaniquement une dégradation du solde de la balance courante du pays à la croissance plus élevée. L’effet induit de ce phénomène était inéluctablement une contrainte d’alignement sur les taux de croissance les moins élevés des grands pays du SME.
La création d’une monnaie unique, en substitution du SME, participait donc structurellement de cette réflexion. D’une part, une monnaie unique permettait une dépréciation du dollar, provoquant un effet homogène sur les pays de la zone euro. D’autre part, la création de la monnaie unique pouvait laisser penser que des marges de manœuvre de politique conjoncturelle pouvaient être dégagées : le solde de la balance courante devait pouvoir alors se considérer au seul niveau de la zone et non plus de chaque pays.
Cela devait permettre à un pays de relancer son économie, si cela s’avérait nécessaire, sans buter immédiatement sur la contrainte extérieure, dès lors que l’ensemble de la zone ne dégradait pas son solde courant. L’exemple mis en avant était celui des États-Unis, au sein desquels un État pouvait relancer seul sa conjoncture sans frein immédiat dû à son propre solde courant. Enfin, une monnaie unique entre les pays considérés, sans possibilité de dévaluation-réévaluation, devait permettre aux acteurs économiques d’avoir une base plus stable de prévisions pour leurs investissements à l’étranger et leurs échanges, importations ou exportations, et de ne plus supporter les charges liées au change des devises les unes contre les autres.
Fédéralisme vs. convergence
À la création de la zone euro, deux écoles de pensée coexistaient tacitement. L’une et l’autre concevaient clairement qu’une telle zone monétaire ne pouvait fonctionner correctement sans complément.
La première école comprenait que, pour devenir efficiente et pour disposer d’une autorégulation satisfaisante, la zone euro devait progressivement être complétée d’un niveau de fédéralisme supérieur. En effet, la seule création de la monnaie unique était insuffisante pour apporter les modes de régulation nécessaires aux perturbations éventuelles. Dès lors qu’un pays au sein de la zone pouvait connaître un choc récessif interne isolé, il lui fallait s’ajuster sans pouvoir bénéficier d’une quelconque dépréciation ou dévaluation de sa monnaie. En l’absence de tout mode de régulation fédéral, la seule possibilité pour un tel pays consistait alors à abaisser ses coûts salariaux et ses dépenses publiques et sociales de façon à regagner de la compétitivité, en provoquant, en quelque sorte, une dévaluation interne, forcément douloureuse socialement et certainement coûteuse en termes de croissance économique pendant les premières années de l’ajustement.
Si l’on voulait éviter des ajustements « par le bas » trop coûteux, il fallait alors deux conditions clairement identifiées théoriquement. D’une part, une mobilité de la main d’œuvre entre les pays de la zone permettant aux personnes perdant leur emploi dans un pays d’en retrouver un autre dans un pays de la même zone. D’autre part, une solidarité budgétaire entre les pays ayant une même monnaie, de façon à organiser des transferts budgétaires des pays à plus forte croissance vers les pays en difficulté, allégeant ainsi la tâche d’ajustement interne de ces derniers pays. Cette situation est exactement celle des États-Unis, grâce à une langue commune et à une pratique historique de mobilité de la population, et grâce à un budget fédéral d’un niveau suffisant pour permettre ces transferts.
L’Europe n’avait pas historiquement cette mobilité, ni le cadre institutionnel légal et social unifié permettant de l’inciter. Mais, en poursuivant sa construction, elle pouvait atteindre un degré de fédéralisme plus élevé autorisant des transferts budgétaires, sous condition expresse d’une supervision budgétaire de chacun des pays par le niveau fédéral, la solidarité ne pouvant se développer sans contrôle préalable du sérieux des politiques menées nationalement. Telles étaient les réflexions de cette école de pensée qui fondait ses espoirs sur la continuation d’une construction européenne, jusqu’alors faite par l’économique avant de procéder aux avancées politiques nécessaires.
L’autre école de pensée, qui s’imposait dès lors que l’on n’osait ou ne voulait afficher des objectifs fédéralistes, était de ne laisser entrer dans la zone monétaire européenne que des pays très similaires et devant le rester ; d’où la création justifiée dans ce cadre des critères de convergence. Si les pays membres d’une zone monétaire sont en phase conjoncturelle et convergent en termes de taux d’inflation, de déficit budgétaire sur PIB, comme de dette publique sur PIB, et qu’ils le restent une fois entrés dans la zone, les ajustements entre pays membres ne sont plus nécessaires. Il n’y a plus lieu alors d’attendre un surcroît de fédéralisme.
Erreurs partagées
À la lecture des événements des dernières années, les deux écoles de pensée ont été dans l’erreur.
La première, puisque le surcroît de fédéralisme, considéré comme devant nécessairement suivre la création de la zone, ne s’est pas produit et qu’il s’est révélé difficile de faire émerger des solidarités internationales ex nihilo.
La seconde, puisque les pays entrés dans la zone n’ont pas tous été choisis sur une base de forte proximité économique structurelle et conjoncturelle, pour des raisons politiques ou car certains de ces pays ont volontairement occulté certains traits de leur économie. Erreur, en outre, parce qu’une union monétaire ne conduit pas naturellement à préserver une convergence, eût-elle existé à sa création, mais tout au contraire induit progressivement des divergences structurelles dues à des polarisations industrielles sur certaines régions de la zone, correspondant à des désindustrialisations d’autres régions. Une même politique monétaire, adaptée à la moyenne des pays de la zone et non à chaque conjoncture spécifique, comme la suppression du risque de change, conduit en fait à des spécialisations économiques nationales divergentes, pouvant mener certains pays à connaître structurellement des déficits de balance courante de par une industrialisation insuffisante.
Les marchés financiers eux aussi s’y sont trompés. Ils ont maintenu un taux d’intérêt des dettes publiques des différents pays de la zone à des niveaux très similaires, alors que l’on connaissait progressivement des divergences considérables, tant dans les ratios d’endettement public que dans ceux des déficits courants.
Ces erreurs de politique et de marché ont amené à l’éclatement d’une crise majeure spécifique à la zone euro, non pas due à de mauvais résultats et ratios en termes consolidés, mais à des divergences de plus en plus fortes entre pays de la même zone, sans que les mécanismes de régulation de tels phénomènes aient été à l’œuvre ou, même, aient été prévus.
Comment sortir des cercles vicieux de la crise ?
La résolution des problèmes intrinsèques de la zone euro s’est révélée dès lors extrêmement difficile, douloureuse et peu lisible.
Se sont enclenchés deux cercles vicieux qui ont accéléré les processus de crise. Le premier est la boucle qui s’est formée entre taux de croissance économique, taux d’intérêt de la dette publique et déficit public des pays en difficulté. Pour redresser la situation des comptes publics et sa compétitivité, un pays doit abaisser son niveau de dépenses publiques et augmenter ses taux d’imposition brutalement, de même que faire baisser ses coûts salariaux – alors même que plusieurs pays de la même zone le font simultanément. Les effets sur la conjoncture économique sont dès lors très défavorables. Le multiplicateur budgétaire dans de telles circonstances – avec un environnement de croissance très faible – a été calculé, y compris par le FMI. Il est supérieur à 1 : une baisse donnée des dépenses publiques en Europe engendre une contraction encore plus grande en proportion de l’activité économique. La baisse de croissance induite dégrade à nouveau le déficit public, ce qui inquiète les marchés et fait augmenter alors le taux d’intérêt de la dette publique. Ce qui à son tour rétroagit négativement sur le niveau du déficit public.
Le second cercle vicieux enclenché consiste en une boucle entre les banques et la dette publique d’un même pays. Les banques européennes détiennent, en placements de bon père de famille, des titres sur leur État, et d’ailleurs sur les États des autres pays de la zone, eu égard à une forte intégration financière dans l’union monétaire. La crainte sur la solvabilité de ces États a donc enclenché une défiance vis-à-vis de ces banques qui, si cette défiance dégénérait en crise systémique, ne pouvaient être sauvées que par leur État, aggravant immédiatement la crainte sur la dette publique.
La zone euro, par tâtonnements successifs, a tenté de sortir de cette grave crise et de ces boucles auto-entretenues. Là encore, deux grandes tendances issues des deux écoles décrites précédemment se sont fait jour, même si celles-là ont pu s’interpénétrer, voire converger.
La première a soutenu que la sortie dépendait de la capacité européenne à créer davantage de fédéralisme, capacité renforcée par la crise. La seconde a avancé que chaque pays en difficulté devait retrouver par lui-même une compétitivité par des efforts suffisants sur ses coûts et sur ses déficits. À nouveau, ces deux tendances ne s’excluant pas totalement ont convergé vers les compromis européens que nous avons connus.
Ainsi, après quelques errements trop longs, les décideurs politiques et la BCE ont heureusement décidé la création d’un fonds d’intervention européen, mutualisant ainsi de facto une partie de la dette publique des pays en difficulté, et la création de l’Union bancaire européenne. L’union bancaire est un élément constitutif et essentiel d’une zone monétaire parce qu’un niveau de supervision européen des banques est nécessaire. En effet, il existe parfois une suspicion vis-à-vis de certains superviseurs nationaux quant au fait qu’ils protègent trop leurs banques ou qu’ils s’aveuglent eux-mêmes. Une supervision au niveau européen est d’autant plus valable que nos banques sont aussi multinationales en Europe, afin d’assurer ainsi une homogénéité du contrôle prudentiel tant en terme de qualité qu’en terme d’efficacité. Mais l’argument central en faveur d’une supervision européenne est qu’il ne peut y avoir de solidarité acceptée sans supervision partagée. C’est pourquoi l’accord récent conditionnait la mise en place des autres éléments essentiels de l’union bancaire.
Cette solidarité inquiète les banques en bonne santé parce qu’elles craignent de pâtir de la situation des banques moins bien portantes. Or c’est bien le contenu de la solidarité interbancaire européenne qui se construirait par la constitution d’une garantie des dépôts, éventuellement à plusieurs étages. Au-delà des garanties de dépôts nationales existantes, des garanties de dépôts s’enclencheraient ainsi, à certains moments, après épuisement des garanties de niveau national, au niveau européen directement, sur la base d’une solidarité des banques européennes des autres nations. Cette solidarité interbancaire serait complétée par une solidarité entre les États de la zone. Un système européen de résolution des crises, avec notamment un fonds d’intervention européen, nourri par les États, devrait voir le jour. Un tel fonds éviterait que la recapitalisation des banques doive se faire nécessairement par un État isolé. Il mettrait ainsi fin au deuxième cercle vicieux évoqué ci-dessus.
La BCE a annoncé qu’elle avait dorénavant la possibilité d’acheter ad libitum des dettes publiques des pays en difficultés, dès lors que leur taux d’intérêt dépassait un niveau considéré comme normal et autorisant une trajectoire de retour à une meilleure solvabilité, sous réserve qu’ils mènent une politique structurelle le permettant.
Ces décisions fondamentales – fonds d’intervention, union bancaire et politique d’intervention illimitée, mais conditionnée de la BCE – ont permis de retrouver la confiance et de casser au moins temporairement les deux cercles vicieux des crises énoncées ci-avant. Aujourd’hui, la question posée par la communauté des économistes est de savoir si les efforts réalisés par chaque pays – couplés aux mesures précitées – permettront d’assainir structurellement la situation de la zone euro et de se préserver en tant que telle, en assurant une convergence durable des pays participants.
Les alternatives à l’austérité
Les efforts intenses réalisés par les pays du sud de l’Europe induisent des coûts sociaux immenses, en termes de niveau de vie et de chômage. En moyenne, ces pays n’ont pas amélioré – voire ont détérioré – leur ratio dette publique sur PIB, eu égard à l’effet multiplicateur supérieur à 1 des mesures budgétaires. Cependant, certains pays comme l’Espagne commencent à voir leurs efforts porter des fruits lisibles dans le redressement de la balance courante et l’augmentation des exportations.
Dans le cas de la Grèce, la suppression d’une partie importante de la dette grecque détenue par le secteur privé semble ne pas suffire au redressement du pays alors même que, là encore, les coûts sociaux et économiques des mesures sont considérables. L’Italie a décidé de réformes structurelles importantes, mais a des difficultés à afficher un redressement de sa compétitivité et semble s’épuiser en combats politiques incertains, ce que viennent de confirmer les dernières élections. Le redressement constaté des balances courantes des pays en difficulté, à l’exclusion de l’Espagne, vient plus souvent d’un affaissement des importations dû à la récession que d’une hausse de leurs exportations expliquée par un surcroît de compétitivité.
La question est donc de savoir si la quête douloureuse simultanée d’un surcroît de compétitivité par une cure d’austérité dans chaque pays concerné isolément, sans avoir recours à l’ajustement par les cours de change, peut être fructueuse. La récession durable provoquée affaiblit en effet la croissance potentielle. Même en supposant un succès à terme, le redressement des comptes publics et des exportations peut-il être suffisamment rapide pour que les coûts sociaux ne se traduisent pas antérieurement par une crise politique et sociale qui viendrait compromettre l’équation européenne et les efforts jusqu’alors consentis ?
À supposer enfin que le regain de compétitivité parvienne à se matérialiser avant toute crise, la question se pose dans les termes suivants : la zone euro doit-elle se réguler par le seul ajustement « par le bas » des niveaux de vie, afin d’amener certains pays-membres, par des efforts internes considérables, à converger vers des niveaux de déficit et de dette publics plus acceptables et vers un meilleur équilibre de leur balance des paiements ? Dès lors que la base industrielle est faible, l’équilibre ne peut venir en effet que d’une croissance atone n’induisant pas d’accroissement des importations. Ce qui produit alors un phénomène inéluctable de ralentissement durable de la croissance de la zone euro. Ou la régulation de cette zone monétaire doit-elle s’opérer par un mix de réformes structurelles indispensables à des finances publiques plus saines et à une meilleure compétitivité, mais aussi par une politique européenne de soutien de la croissance potentielle, par une véritable coordination des politiques économiques – relance ici et politiques restrictives là – et des transferts entre les différents pays permettant aux moins industrialisés d’entre eux de ne pas être contraints en permanence à l’ajustement par l’austérité ? Ce mix pourrait aider à ce que ces changements structurels puissent se faire sans brutalité excessive et sans entraîner de récession violente, donc en permettant à ces réformes d’être plus acceptables. Les réformes structurelles réussies par le Canada et la Suède notamment, dans les années 1990, ont été largement facilitées par des politiques conjoncturelles accommodantes qui ont permis de rendre acceptable le coût social transitoire de ces mesures. Ce mix ne manquera pas de comprendre également une meilleure supervision des politiques budgétaires notamment, car on ne peut concevoir de solidarité sans contrôle, si l’on souhaite éviter tout effet d’aléa moral.
L’interrogation finale est la suivante : la zone euro peut-elle développer un degré de fédéralisme supplémentaire – supervision, coordination des politiques économiques et transferts budgétaires – qui permettrait d’assurer un degré supérieur de solidarité entre ses membres, sans pour autant accepter de laxisme, ni de comportement de free rider ? Cela permettrait alors, non seulement, comme dit ci-dessus, de réaliser les indispensables réformes structurelles dans nombre de pays de façon organisée et mieux planifiée sur un temps plus long, donc moins douloureusement et avec moins de risques, mais aussi de reconnaître et d’assumer la diversité naturelle des pays composant la zone, y compris la diversité induite sur le plan industriel notamment par l’existence même de la monnaie unique.
Cela favoriserait un niveau de croissance moyen plus élevé, en autorisant certains pays à connaître des déficits courants alors que d’autres afficheraient des excédents. Ou alors, incapable de dessiner cette évolution politique, la zone euro est-elle condamnée à exiger trop vite et trop durablement une politique d’austérité dans les pays les moins industrialisés, conduisant alors à un niveau moyen de croissance pour l’ensemble de la zone durablement très affaibli, avec les risques politiques induits. Et peut-être finalement des risques sur l’euro lui-même.
Article publié dans la Nouvelle Revue de Géopolitique, n° 9, Avril-Mai-Juin 2013
Télécharger : L’avenir de la zone euro – Nouvelle Revue de Géopolitique 2013 04 (PDF)