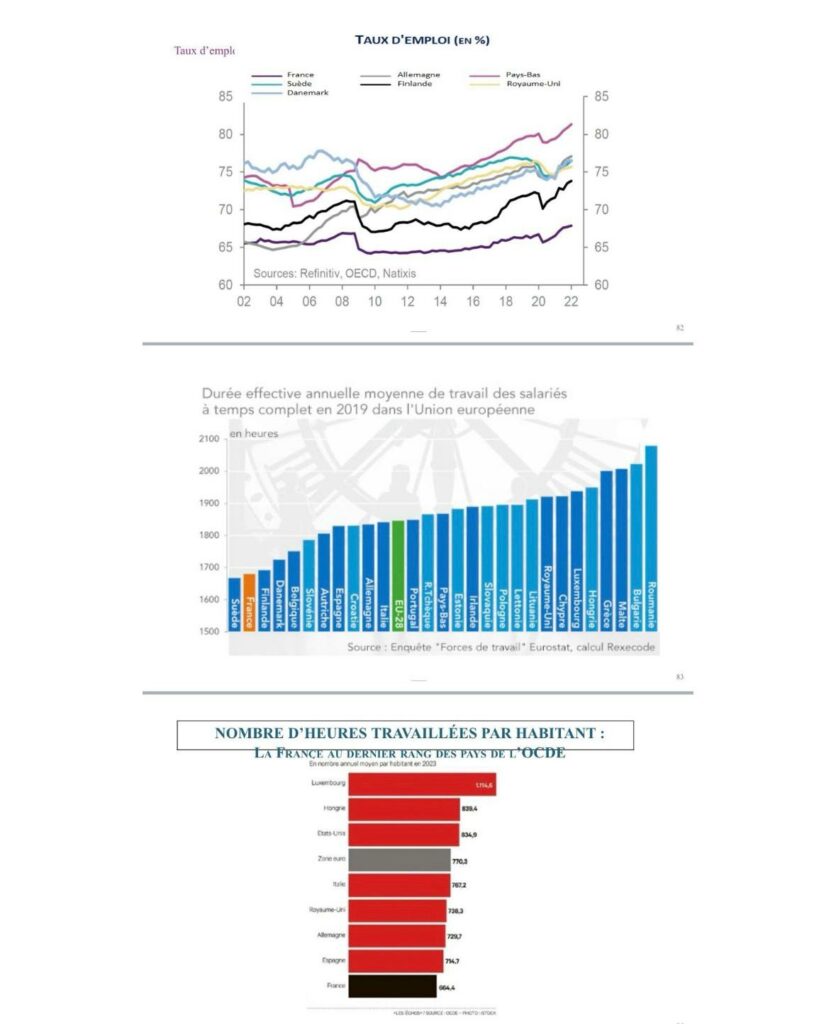La pensée sociale-démocrate, telle qu’elle existe en France, a vécu. Elle a beaucoup apporté pendant des décennies. Mais son modèle intellectuel n’a pas beaucoup évolué, alors que, sans même parler de la nécessaire transition climatique, a minima quatre mouvements d’importance se sont produits : la question de l’autorité publique, de la sécurité et du phénomène migratoire avec le développement de l’idéologie islamiste, tout d’abord, embarquant ainsi la réflexion sur ce qui fait nation. La montée d’un individualisme farouche, ensuite, avec la survalorisation des droits de chacun et la dévalorisation des devoirs. Troisième mouvement, l’obsession de l’égalité, impliquant un dangereux égalitarisme, au détriment-même de la recherche de l’égalité des chances et de l’équité. Le développement enfin d’une hypertrophie de la sphère publique, dont l’entropie engendre inefficacité, découragement, perte de confiance et montée de l’inquiétude.
Nous nous intéresserons ici particulièrement à l’obsession de l’égalité, et avec elle à la pente naturelle de la démocratie comme de la social-démocratie, sur leur dynamique endogène : ce que j’appelle l’hyper-démocratie et l’hyper social-démocratie. Toutes deux peuvent en effet produire par elles-mêmes leurs propres excès. Si l’on ne développe pas une réflexion approfondie sur ces trajectoires, la démocratie, de même que la social-démocratie, peuvent conduire à leur propre affaiblissement, mais aussi, au bout du chemin, à leur possible disparition. Avec en point de mire l’avènement au pouvoir du populisme, fût-il très à droite ou très à gauche.
De l’hyper-démocratie
Tocqueville déjà prévenait de cette logique endogène à la démocratie : le droit de tous, étendu, sans fin, à tout, opposable à tous les autres, et symétriquement, l’abandon progressif des devoirs — c’est-à-dire l’individualisme poussé au maximum et l’essor d’un communautarisme animé par la revendication de droits spécifiques. L’un comme l’autre peuvent être vus comme des signes de repli sur soi avec, en surplus, comme manifestation et justification idéologiques du phénomène, une vision moralisante et simplifiée de la société l’idée où chacun est obligatoirement oppresseur ou oppressé. La simplicité de cette idéologie va de pair avec la vigueur des normes qu’elle impose. Cette nouvelle bien-pensance conduit, à rebours des déclarations de ses promoteurs, à la haine de l’autre, des autres, accablés de la faute d’être l’oppresseur par assignation préétablie à résidence et à culpabilité indélébile. Ces oppresseurs ayant privé de leurs droits les oppressés, ces derniers se voient délivrés, en retour, de tout devoir comme de toute responsabilité. Le salut éventuel du présumé oppresseur ne pourra survenir que dans le cas d’un complet reformatage, d’une restructuration de l’individu ayant avoué ses fautes et s’étant ou ayant été rééduqué. Ce fantasme se joue dans une manipulation de l’histoire réécrite à travers l’unique et simplissime couple oppresseur-oppressé, chacun étant pour toujours, ou presque, affecté dans sa case d’origine. Toute ressemblance avec le totalitarisme…
Cette idéologie ne s’avoue pas comme telle. Elle se cache derrière des mots devenus totem, et répétés inlassablement. Des mots vidés, énucléés, mais obligatoires, parce qu’appartenant au camp du bien. La police des mœurs va de pair avec une police de la pensée : d’autres mots sont interdits, honteux. Le wokisme est à l’évidence la caricature et l’expression aujourd’hui la plus aboutie de ce dévoiement du concept de démocratie. Il n’en est en rien une extension : il est la nouvelle idéologie de ses excès, idéologie in fine destructrice de la réalité-même de la démocratie.
La pensée sociale-démocrate ne peut ni ne doit laisser la critique et le combat contre le wokisme au populisme. Car elle risque sinon de s’y dissoudre elle-même, jusqu’à disparaître. L’exemple américain le montre bien, avec un Parti démocrate défait face à Trump jusque dans ses bastions géographiques et, ironie de l’histoire, abandonné par une partie conséquente des électeurs appartenant à des minorités. En France, le cas du Parti socialiste d’aujourd’hui en est un exemple également frappant, happé, sauf sursaut délibéré encore possible, par un NFP organisé autour des idées de LFI.
Les excès de la social-démocratie
Doivent également et parallèlement être pensés et analysés les excès de la social-démocratie elle-même. Sans omettre que la social-démocratie et la démocratie sont évidemment deux concepts non totalement distincts. Nous les distinguons ici formellement, parce qu’ils ne se résument pas l’un à l’autre, aussi bien que pour faciliter l’analyse. Ses excès, développés aussi de façon endogène, peuvent être résumés dans la recherche de l’égalité poussée à l’extrême. Cet horizon d’une égalité parfaite anime une pensée magique, qui s’abîme dans ses propres contradictions : l’égalité en tout, de tous avec chacun, conduit en effet à la jalousie généralisée. Comment ne pas voir qu’une société ainsi aplatie — par la fiscalité, par la redistribution, par différentes politiques publiques – est le lieu des passions tristes ?
Une telle vision condamne aussi ce qui fait la dynamique d’une société, le moteur de l’effort et la recherche de la progression – en d’autres termes, de ce qui fait le progrès. Tocqueville encore : « Il n’y a pas de passion si funeste pour l’homme et pour la société que cet amour de l’égalité, qui peut dégrader les individus et les pousser à préférer la médiocrité commune à l’excellence individuelle. »
La social-démocratie, sans réflexion sur elle-même et sans régulation de ses propres dérives, connaît ce genre de glissement fatal. Doivent donc être étayées à nouveau les différences entre égalité « absolue », égalité des droits, égalité des chances et équité. Et leurs conséquences réciproques, morales, économiques et sociales.
Aussi, l’hyper démocratie comme l’hyper social-démocratie induisent-elles des régressions et un potentiel d’extinction progressive de la dynamique des sociétés et des économies, donc du bien-être. Elles conduisent à la faillite financière, et donc à la faillite sociale. Mais aussi, et cela va de pair, elles abîment gravement la capacité de vivre ensemble et de respecter les compromis nécessaires entre liberté et règles. Donc elles amènent à la faillite morale. En laissant les passions les plus basses s’exprimer en toute impunité : la jalousie, le ressentiment, la haine. Elles sont pourtant déjà à l’œuvre.
l n’y aura ni renouveau de la pensée social-démocrate, ni diminution de la méfiance actuelle vis-à-vis de la démocratie, sans cet effort d’analyse de la montée naturelle des excès propres à la démocratie et à la social-démocratie et de leur hypertrophie, de la suradministration et de ses effets, de même que du besoin légitime et républicain d’un retour de l’autorité publique et que d’une meilleure régulation et intégration de l’immigration. La montée généralisée du populisme ne trouve certes pas son origine que dans ces facteurs-là. Mais il serait dangereux de nier que son développement a également sa source ici.
Toute la question est ainsi la capacité de la démocratie et de la social-démocratie (et de façon intimement liée la sphère publique) à ne pas tomber dans l’entropie et à se stabiliser à un point d’équilibre qui marie durablement l’éthique (ou la justice) et l’efficacité (la production de richesse) et le bien-être économique et social. Il s’agit d’une question de survie de notre modèle économico-social européen. Avec ses défauts spécifiquement français, rendant le système de plus en plus inefficient, notre modèle de régulation sera tôt ou tard incapable de se reproduire, c’est-à-dire de survivre. Avec pour corollaires, si le sursaut ne vient pas à temps, un appauvrissement généralisé et une déconfiture morale et financière.
La réflexion doit donc se poursuivre. Comment induire des mécanismes de limitation de ces excès ? Comment retrouver les équilibres vitaux qui permettent à nos sociétés de survivre et de se revigorer ? C’est tout l’enjeu. C’est une question fondamentale pour notre avenir, notre « modèle », notre Europe et notre pays.
Ce texte est extrait d’une note plus longue, publiée sur le site d’Olivier Klein : « La pensée de la social-démocratie doit se renouveler profondément en France ».