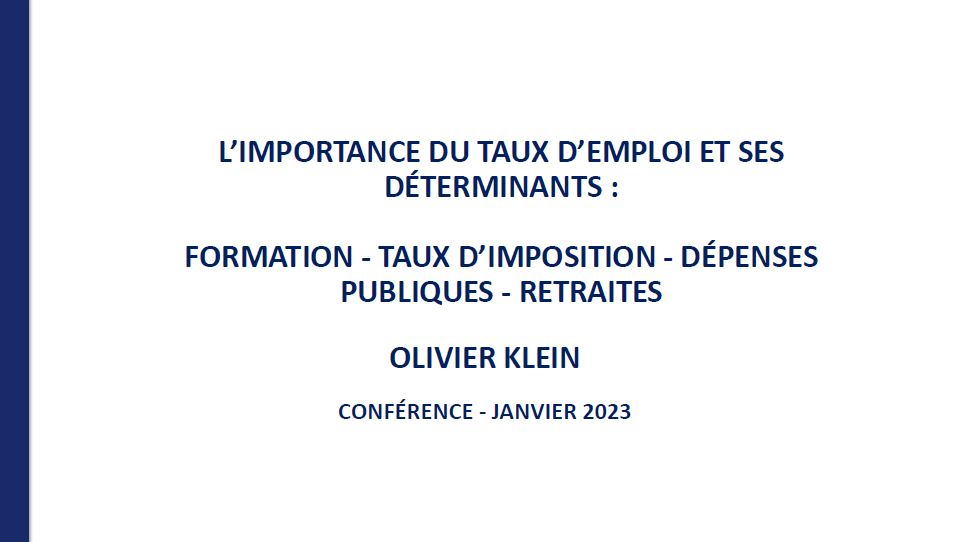L’inflation est de retour et elle n’est pas que transitoire. Que faire ? Financer la croissance. Le chemin est très étroit mais il existe.
Les faits ont tranché. Certains économistes assuraient ces dernières années que la dette n’avait pas d’importance car ils pensaient que les taux d’intérêt très bas par rapport au taux de croissance (i-g négatif) se maintiendraient très longtemps. Une analyse qui, d’une part, reposait sur une anticipation audacieuse sur l’inflation future, et qui, d’autre part, ne prenait pas en compte la contrainte budgétaire qui, même si elle est faible lorsque le taux d’intérêt est inférieur au taux de croissance, existe malgré tout (1). Donc, cette assertion conduisait à recommander de dépenser davantage, certes pour faire face aux grands enjeux que nous connaissons, mais sans se soucier d’une dette en expansion permanente. Comme si les banques centrales étaient entrées dans une politique illimitée de « quantitative easing », tant en durée qu’en montant. J’ai expliqué antérieurement pourquoi (2), même à supposer que l’inflation ne revienne pas, ce qui n’était pas écrit, une telle situation pouvait ne pas être durable eu égard aux vulnérabilités financières qu’elle accroissait. Ou à la possibilité d’une récession majeure. Ou encore, in fine, le système monétaire étant un système de règlement des dettes, à la confiance dans la monnaie qui pourrait disparaître parce que les dettes ne peuvent être sans cesse en expansion plus rapide que l’économie réelle.
Aujourd’hui, l’inflation est revenue (3 et 4) et elle n’est pas que transitoire. Analysons ainsi les conséquences de son retour en force pour tous les acteurs.
Les banques centrales : elles doivent lutter contre l’inflation. C’est indispensable car il faut éviter, en effet, un régime inflationniste, c’est-à-dire un système où l’indexation serait enclenchée entre les prix et les prix, les prix et les salaires, les salaires et les prix. Où donc le taux d’inflation n’est ni faible ni stable. Une telle inflation crée des inégalités entre les ménages qui n’ont évidemment pas tous la même capacité à réagir pour protéger leur pouvoir d’achat. Elle conduit également à des inégalités entre les entreprises qui n’ont pas toutes la même capacité à « faire les prix ». En outre, l’histoire nous l’a montré, dès lors que la stabilité et la prévisibilité du taux d’inflation se dérèglent, la confiance vient à manquer entre les acteurs économiques, entre les producteurs et les consommateurs. On ne sait plus fixer facilement les prix et il devient nécessaire de les refixer plusieurs fois par an, voire bien davantage en cas d’hyperinflation. Ce qui abîme la confiance. Entre les salariés et les entreprises où les représentants des salariés peuvent être conduits à demander une seconde négociation dans l’année, ou plus. Ce qui désorganise la fiabilité de la négociation entre les salariés et les dirigeants de l’entreprise, provoquant ainsi des tensions. Entre les prêteurs et les emprunteurs, les prêteurs ne sachant plus comment fixer les taux de crédit, puisque les taux d’intérêt augmentent sans cesse. Cette incertitude généralisée est ainsi créatrice de tensions et mine la confiance qui est l’une des clés de voûte de l’efficacité économique, de la croissance, comme de la vie en société. C’est ainsi qu’une inflation plutôt basse et stable, idéalement autour de 2 % ou 3 %, est plus que souhaitable et que les banques centrales n’ont pas d’autre choix que de mener une politique monétaire qui, au mieux, permet d’assurer en permanence ce niveau et, le cas échéant, d’y ramener.
Pour indispensable qu’elle soit, cette mission des banques centrales est difficile dans les circonstances actuelles. Une remontée trop vive ou trop forte des taux d’intérêt peut aisément provoquer une récession, un « hard landing ». Elle pourrait être en effet trop fortement calibrée, si l’on pense que la composante transitoire de l’inflation actuelle s’affaiblira prochainement. Les contraintes d’offre peuvent et doivent en effet s’atténuer dans le temps, hors conséquences du développement de la guerre en Ukraine qui pourrait accentuer les pénuries d’énergie et de certains produits agricoles.
Mais une remontée trop lente des taux d’intérêt conduirait à ne pas assez combattre le retour d’une forte inflation en laissant se développer les indexations. Et réagir tardivement, une fois que les anticipations d’inflation ne sont plus ancrées à un niveau bas et que les indexations se sont mises en place, coûte beaucoup plus cher en termes de croissance, les récessions profondes étant alors difficilement évitables.
Mais il y a plus. La mission des banques centrales est d’autant plus délicate que nous avons connu des taux d’intérêt trop bas, trop longtemps. Il fallait bien sûr conduire les taux longs et courts vers zéro pour sortir de la crise majeure de 2007-2009 et du risque de déflation qu’elle induisait. Il le fallait aussi pendant la pandémie. Mais, dès le retour de la croissance (en 2016-2017), conserver des taux d’intérêt aussi bas, sous prétexte que le taux d’intérêt naturel était très bas, était dangereux. D’ailleurs, le taux d’intérêt naturel est un concept et non une variable observable. Ni théoriquement fondé de façon indiscutable (5), ni facilement utilisable. De même, il est possible que le taux d’inflation très bas de la période – que les politiques de « quantitative easing » ne sont d’ailleurs pas parvenues à remonter – ait été dû à des forces structurelles (mondialisation et révolution technologique), avec une courbe de Phillips rendue plate de ce fait, et non à une insuffisance de la demande, donc à un phénomène cyclique. Maintenir ainsi des taux trop bas trop longtemps a entraîné des conséquences que la Banque des Règlements Internationaux décrit très bien depuis des années. Quand le taux d’intérêt est trop bas par rapport au taux de croissance pendant trop longtemps et que l’on est en phase de croissance, les bulles se construisent. Bulles actions, bulles immobilières et surendettement des États comme des agents privés. Aujourd’hui, si les taux doivent être remontés et les politiques de « quantitative easing » prendre progressivement fin face à un risque majeur de changement de régime d’inflation, les actifs patrimoniaux (actions et immobilier) étant très valorisés et le niveau de dette mondiale étant très élevé, les banques centrales doivent faire face au risque d’éclatement brusque de ces bulles et de crises de solvabilité des acteurs économiques trop endettés. Avec les risques induits en retour sur la croissance (6). Cette situation de vulnérabilité macro-financière est donc nécessairement problématique pour les banques centrales et elles doivent, de ce fait, se montrer tout à la fois très déterminées et très prudentes. C’est pourquoi elles ont entamé la normalisation de leur politique et iront sans débat jusqu’à ce qu’elles estiment être leur neutralisation ( c’est à dire une politique monétaire ni restrictive ni favorisant la croissance ) vers la fin de l’année 2022 ou le début de 2023. Mais une fois ce stade atteint, elles agiront en fonction des circonstances. Si le ralentissement de la croissance s’accroît brutalement, si les marchés chutent fortement, elles aviseront. L’état de l’indexation des salaires et des prix, donc du niveau de l’inflation sous-jacente, sera alors scruté, pour s’interroger sur l’opportunité ou le danger de positionner les taux d’intérêt au-dessus des taux déjà atteints . Si la trajectoire d’inflation ne prenait pas un chemin baissier satisfaisant, gageons que les banques centrales continueraient alors à resserrer leur politique monétaire pour la rendre mordante , tant par une remontée plus forte des taux directeurs ( donc courts ) que par un « quantitative tightening » soutenu aux États Unis et par son initiation en zone euro , contribuant ainsi à faire remonter plus fortement et plus rapidement les taux d’intérêt longs.
Les banques centrales doivent rester crédibles face à l’inflation. Elles doivent être claires dans leur discours en affichant une détermination sans faille pour lutter contre elle. En revanche, elles doivent être graduelles et prudentes dans l’action, sans toutefois être sous domination des gouvernements ou des marchés financiers.
Les gouvernements, quant à eux, n’ont d’autre choix que d’afficher une trajectoire de solvabilité crédible à moyen terme (7). Une politique budgétaire trop rigoriste et trop brutale conduirait à casser la croissance, mais ne rien faire lorsque le niveau d’endettement est élevé entacherait considérablement leur crédibilité, ce qui provoquerait un risque élevé sur les marchés de la dette publique à court terme. Il faut donc mettre en place une politique de gestion des finances publiques sans austérité, mais qui soit en réalité une sortie des politiques de soutien tous azimuts, avec une concentration sur les populations les plus faibles. La pandémie par essence inattendue, brutale et passagère est en effet à clairement différencier d’un changement possible de régime d’inflation.
En outre, il faut financer les investissements nécessaires à l’augmentation de la croissance potentielle ou à la croissance verte. Mais ce financement doit être gagé par une gestion plus rationnelle et plus efficace des dépenses publiques, notamment des dépenses courantes, de même que par les réformes structurelles (8). Ces dernières sont strictement nécessaires à l’augmentation de la croissance potentielle, aux finances publiques, comme à l’accroissement de l’offre, lui-même facteur de lutte contre l’inflation. Certaines politiques de l’offre peuvent avoir des effets positifs rapidement, d’autres plus à moyen terme, tant sur l’inflation que sur la croissance. Il s’agit ici notamment des politiques qui permettent d’accroître le taux d’emploi, dont la réforme de la retraite, comme celle de l’indemnisation du chômage. La pénurie d’emplois de ces derniers mois empêche en effet l’offre de biens et de services d’être plus élevée, de même qu’elle soutient le phénomène d’indexation (partielle à ce jour) des salaires.
Les entreprises trop endettées, par exemple au regard de ratios proposés par la BCE elle-même, doivent mener une politique de désendettement raisonnable mais réelle pour mieux aborder cette période de remontée des taux d’intérêt et de moindres facilités de financement à venir.
Pour les ménages, se pose la question du pouvoir d’achat (9). Il sera difficile de le préserver totalement. Du côté des entreprises, en effet, il ne sera pas possible d’indexer systématiquement les salaires sur l’inflation. D’ailleurs, depuis 1983, la loi Delors et Bérégovoy interdit aux entreprises d’indexer les salaires sur les prix. Si elles le faisaient, elles précipiteraient la montée de l’inflation et détruiraient en outre leur compétitivité ou leur rentabilité, ce qui réduirait gravement dans les deux cas leur possibilité d’investissement et d’emplois ultérieurement. Les entreprises ne peuvent donc pas tout faire. Et, elles ne peuvent faire qu’en fonction de leur situation spécifique. Impossible également pour les États d’assurer longuement une protection de tous contre l’inflation, car pour nombre d’entre eux leurs marges de manœuvres budgétaires sont déjà éprouvées. Notons également qu’une telle politique est contraire à celle menée par les banques centrales. Cette non-coopération entre les politiques économiques pourrait s’avérer dangereuse en termes de stabilité financière. Le soutien généralisé du pouvoir d’achat, côtoyant une offre insuffisante, précipite en outre la dégradation du déficit du commerce extérieur, déjà touché par la hausse du coût de l’énergie importée. La remontée des taux d’intérêt accentuera encore fortement les contraintes budgétaires des États, pour ceux d’entre eux qui sont plus endettés. Reste une possibilité pour protéger au mieux le pouvoir d’achat des ménages : nous vivons une situation particulière où l’on doit réduire l’inflation, protéger le pouvoir d’achat et faire face à une pénurie de main d’œuvre avérée. La plupart des entreprises manquent de salariés. Augmenter un peu les salaires en échange d’une remontée modérée du temps de travail pourrait être une partie de la solution, dans la mesure où cela résulterait du choix des entreprises et des salariés eux-mêmes.
Ce serait bon pour la croissance, bon pour les finances publiques et bon pour le commerce extérieur.
Bibliographie :
- r minus g negative: Can we sleep more soundly? Paolo Mauro, Jing Zhou
IMF working papers – March 13, 2020
- Comment éviter le piège de la dette après la pandémie ? Olivier Klein
Revue d’Economie Financière – 20 mai 2021
- Opinion | Pourquoi l’inflation pourrait faire son grand retour Olivier Klein
Les Echos – 6 juillet 2021
- The return of inflation Speech by Agustin Carstens
BIS – 5 April 2022
- What anchors for the natural rate of interest? Claudio Borio, Piti Disyatat and Phurichai Rungcharoenkitkul
BIS Working papers – N° 777 – 26 March 2019
- Opinion | Inflation, taux et dette : le cocktail explosif Olivier Klein
Les Echos – 16 mai 2022
- L’équation nouvelle de la dette dans le prochain quinquennat Olivier Klein
TELOS – 21 avril 2022
- A story of tailwinds and headwinds: aggregate supply and macroeconomic stabilization Speech by Agustin Carstens
BIS – 26 August 2022
- Inflation et pouvoir d’achat : sortir d’une équation impossible Olivier Klein
Les Echos – 15 juin 2022