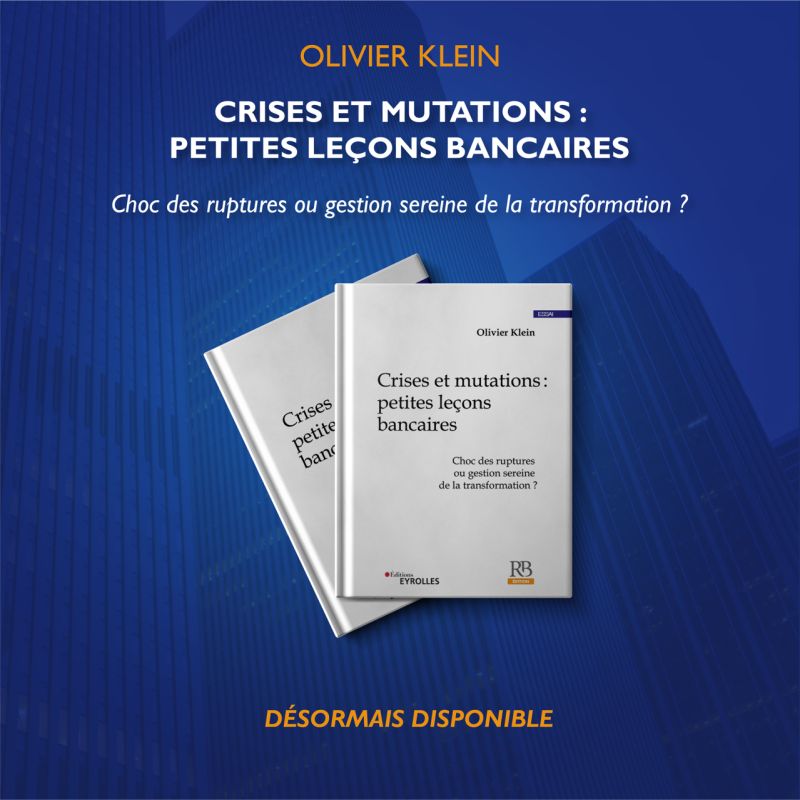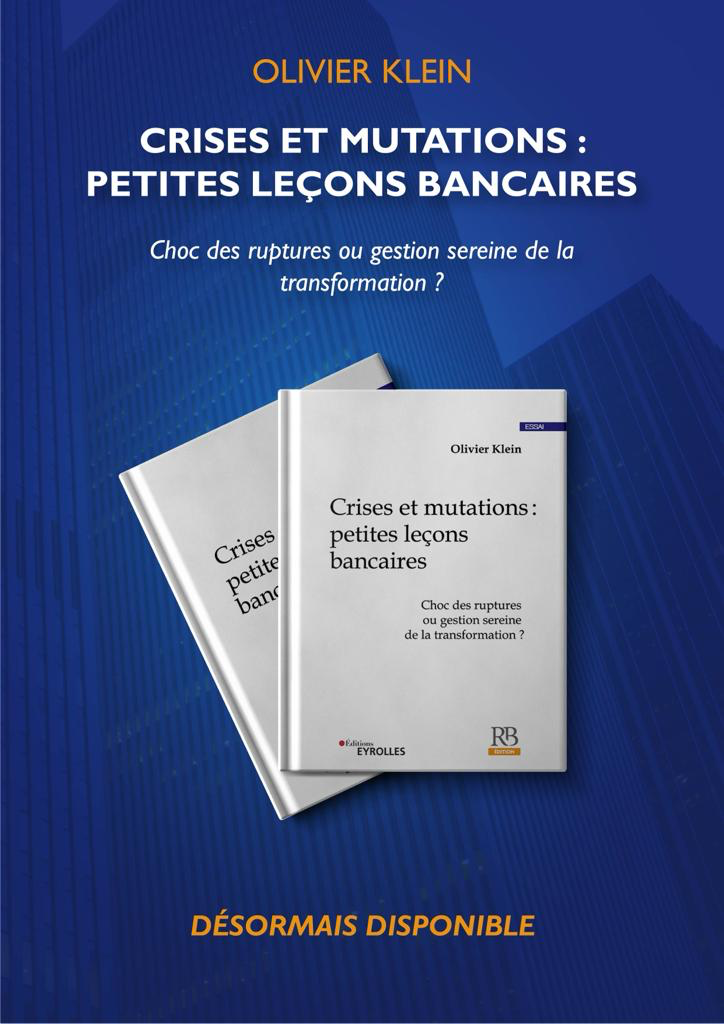Mot d’accueil | Olivier Klein
« Bonjour à tous, ravi de vous recevoir et d’organiser ici, à la BRED, les sixièmes Assises de la coopération et du mutualisme dont nous sommes adhérents et dans lesquelles nous sommes engagés depuis la première année.
Pour cette introduction, je vais rapidement développer trois idées.
La première concerne l’évolution du capitalisme. On sait tous que le capitalisme a démarré sous une forme familiale, puis, parce que les familles évoluaient dans le temps, s’agrandissaient et que les fondateurs disparaissaient, il a fallu ouvrir le capital et se sont développées les sociétés par actions. Ainsi est née, particulièrement à la suite de la seconde guerre mondiale, une forme de capitalisme « managérial » dans laquelle les managers ont davantage pris le pouvoir, parfois au détriment de l’intérêt des actionnaires dispersés et de l’efficacité légitime. En conséquence, dans les années 1980 s’est développé un capitalisme « actionnarial » remettant la balle du côté des actionnaires, avec des formes plus efficaces mais également avec d’importantes dérives. Les innovations efficaces ont permis de faire venir de grands talents dans de petites sociétés en les associant à la réussite, par une participation au capital (sous une forme ou sous une autre), ce qui était difficile sous le capitalisme managérial. Cela a donc facilité l’innovation et les « start up ». Mais on en connaît bien les dérives. Il s’agit de tout ce qui a fait en sorte que les dirigeants d’entreprises soient plus attachés à l’intérêt des actionnaires qu’au reste des parties prenantes. Avec les dérives financières y attenant. Ainsi, selon moi, nous devons évoluer vers un capitalisme « partenarial » qui comprendrait davantage toutes les parties prenantes : les actionnaires, qui évidemment apportent de l’argent et le mettent en risque, mais aussi les salariés – qui eux aussi prennent des risques sous une autre forme –, les clients, les fournisseurs et la société dans son ensemble. Prendre en compte la société s’exprime certes à travers la RSE, mais plus largement par le fait que les entreprises sont engagées vis-à-vis de leurs territoires, de la transition climatique… Il se trouve que la forme mutualiste et coopérative, même si ce n’est pas la seule, est l’une des formes qui s’appliquent bien au capitalisme partenarial. Il est évident que dans nos banques, par exemple, les clients sont au cœur même du système puisque l’actionnariat y est représenté par le sociétariat et que les sociétaires sont des clients. Il n’y a donc pas de sociétaire non-client. Selon les formes, tous les clients sont sociétaires ou tous les sociétaires sont clients (comme à la BRED), mais en tout état de cause ce sont les clients qui forment le Conseil d’administration, ce sont donc eux qui contribuent à forger la stratégie de l’entreprise. Une stratégie, par construction, très orientée client. Les salariés sont également depuis très longtemps au cœur du projet dans nos formes mutualistes et coopératives. Et, bien évidemment, la société l’est aussi. Bien avant que les questions RSE ne soient « à la mode », nous nous engagions déjà avec beaucoup de sincérité dans de nombreux domaines, aussi bien au niveau très local, en soutenant tel club de sport, telle association ou tel événement culturel, qu’à un niveau plus large, comme à la BRED par exemple dans la diffusion du savoir ainsi que dans l’égalité des chances, facteurs très importants pour renforcer le lien social et favoriser la cohésion des territoires.
La deuxième idée que je souhaite développer est qu’un groupe bancaire comme BPCE est un groupe décentralisé de banques régionales coopératives, des banques de plein exercice. Le rôle de nos banques est par construction encore plus fort sur nos territoires que celui des banques centralisées. Car entre chaque territoire et sa banque il y a une osmose, une convergence d’intérêts. Si le territoire ne va pas bien, la banque n’ira pas bien. Et si la banque, par son rôle de facilitateur, ne va pas bien, il y a peu de chance que le territoire se développe bien. Cette osmose provoque donc des choses assez différentes de ce que l’on peut connaître dans d’autres modèles. Le jour où dans telle ou telle de nos régions l’activité de crédit dégage un peu moins de rentabilité, pour une raison de surcroît de risque par exemple, pour autant toute l’épargne collectée dans la région ira financer les développements de projets sur ces mêmes territoires. Elle ne sera pas affectée à une région permettant une meilleure rentabilité des crédits octroyés. C’est fondamental et ce n’est pas le cas partout.
Il y a bien chez nous cette équivalence entre l’intérêt du territoire et celui de la banque qui y travaille. La notion de RSE y est donc encore plus réelle, encore plus concrète. Et dans un monde qui a été fortement globalisé, même s’il se compartimente rapidement, on a vu apparaître depuis des années un besoin encore plus fort de proximité, un besoin auquel, je le pense, nos banques répondent. Lorsque l’on interroge les Français sur les banques, on note un attachement viscéral à nos formes de banques du fait de la proximité qu’elles développent.
Proximité géographique et proximité relationnelle avec les clients -quel que soit le canal utilisé – qui lie le client à sa banque.
Proximité également décisionnelle. Je me rappellerai toujours la première fois où je suis allé à Lyon pour une banque qui était centralisée, les entreprises clientes nous laissaient prendre des parts de marché sur d’autres banques centralisées, mais jamais sur les banques régionales. La raison en est très simple : la banque régionale possède un accrochage local qui est indépassable, car elle a tissé une réelle relation avec le client. Car celui-là connaît les responsables finaux de la banque, qui sont là pour longtemps. En outre, les décisions de crédit sont prises sur place et non à Paris.
Proximité enfin managériale, qui est aussi cruciale. Dans une banque de réseau, on a besoin de collaborateurs très motivés, très conscients de la valeur de nos clients et de l’importance de la relation avec eux. Cette motivation fait la différence. Ce n’est pas pour rien que les banques mutuelles et coopératives en France, depuis 30 ans, ne font que progresser pour aujourd’hui atteindre entre 65 % et 70 % des parts de marché de la banque de détail, y compris sur le marché des PME. Cette proximité managériale permet à tous d’être impliqués dans la stratégie, de la comprendre, d’en être acteurs et ainsi de se sentir bien davantage plus motivés. Parce que les managers sont proches des dirigeants qui sont là, bien présents sur leurs territoires. Et ces dirigeants responsables de leur banque sont attachés à leur région et travaillent dans des banques de plein exercice, ce qui leur donne beaucoup de responsabilité et ce qui développe des dynamiques entrepreneuriales considérables.
En outre, le fait d’avoir un actionnariat « collectif », composé de clients-sociétaires permet à nos banques, de ne pas dépendre de la bourse, de sa volatilité, de ses effets mimétiques, comme de la pression de très court terme qu’elle organise. Sans jamais exonérer nos banques de l’impératif d’efficacité et de rentabilité. Pouvoir penser à long terme et assurer une proximité forte avec ses clients sont ainsi deux atouts essentiels de notre mode de gouvernance.
Ma dernière idée concerne l’alliance de l’éthique et de l’efficacité, idée que je défends depuis plus de 20 ans. Je suis persuadé que notre modèle permet de lier éthique et efficacité de manière remarquable. Rien de tout ce que je viens d’énoncer ne se fait au détriment de l’efficacité, tout au contraire. Il n’y a pas d’efficacité longue sans éthique dans la relation client, comme vis-à-vis des salariés. Je demande toujours aux conseillers de se comporter de la façon suivante : « Accompagnez vos clients de manière à ce que dans 10 ans, lorsque vous les rencontrerez à nouveau dans la rue, vous n’ayez pas l’envie de changer de trottoir et que vous soyez fiers de ce que vous avez fait pour eux ». Et il n’y a évidemment pas d’éthique longue sans efficacité, car si l’on n’est pas efficace, on n’a pas les moyens d’être éthique, puisque tôt ou tard on n’existe plus. Il faut donc lier la morale à l’efficacité, l’une ne pouvant aller sans l’autre et réciproquement.
Pour conclure, cette proximité multidimensionnelle construit la performance, elle permet même la surperformance. Aujourd’hui, les coefficients d’exploitation – rapport entre les charges et les revenus des banques – sont structurellement meilleurs dans les banques de détail des groupes décentralisés que dans l’activité de banque de détail des groupes centralisés. Dans un pays très centralisateur, j’ose dire que c‘est grâce à cette décentralisation bancaire que nous avons des coefficients d’exploitation plus bas, donc que nous sommes plus efficaces. Nous sommes ainsi des banques compétitives, efficaces, et cette efficacité permet de fait de bien mieux servir les clients. Le premier principe de l’éthique est d’être utile à ses clients. Puisque nos modèles mutualistes et coopératifs permettent ce mariage fructueux de l’efficacité et de l’éthique, j’ai la conviction que nous sommes là pour longtemps.
Je vous remercie. »